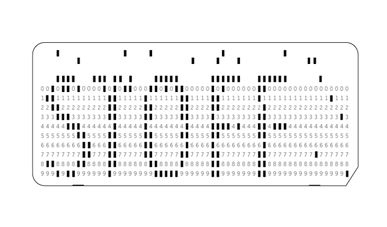Introduction
La dévaluation incessante de la force de travail — à laquelle est contraint le capital selon sa propre loi — ne pourra jamais trouver son achèvement dans l’inessentialisation du prolétariat sans que ce dernier ne lutte contre une dynamique qui se présente à lui sous la forme d’une destruction inexorable de son monde. Dans de telles conditions de survie, le prolétariat et son devenir forment une question riche d’un contenu nouveau. Si autrefois les luttes prolétariennes s’articulaient autour du travail et de toutes ses médiations, elles parlent désormais un autre langage — celui des perdants de la mondialisation — autour des thèmes de la nation et de l’identité. Au croisement du social, du politique et de l’histoire, le peuple s’est invité dans la partie. À voir les réactions qu’il suscite, on devine qu’il n’est pas le bienvenu.
Le prolétariat ne s’est nullement absenté — c’est son sens qui a muté : il était la classe organisée qui monte en puissance jusqu’à renverser la bourgeoisie ; il est désormais le groupement indifférencié des surnuméraires. Pour se libérer de cette condition indigne, il doit nécessairement abolir une société — enrégimentée sous son économie — à laquelle il devient inutile. Une telle abolition, en tant que phénomène historiquement inédit, a pu être annoncée par l’enterrement définitif d’une représentation de soi comme classe du travail, dernière et meilleure relève à la gestion de la production. Et dans le même mouvement où il s’écarterait de son appartenance de classe, le prolétariat entamerait sa propre extinction, embarquant avec lui les autres classes, dans une immense insurrection mondiale.
Hélas la fin de cette identité de classe, et même l’escamotage à peu près total de ce à quoi elle se référait – soit les sans-réserves, les catégories populaires, les ouvriers et les employés, les gagne-petit, les gens de peu, ceux d’en bas, si l’on ne veut plus parler du prolétariat – a introduit d’autres représentations que l’on pensait pourtant moribondes et indissociables de l’ère du nationalisme bourgeois. Pour autant, il n’est pas dit que la reconfiguration en cours de l’antagonisme de classe, reconfiguration que nous choisissons de désigner sous le nom de populisme, soit à terme viable pour le capital : il se pourrait même qu’elle ne soit qu’un détour, un moment de désordre qui nous sépare d’un avenir post-économique ; ou qu’elle détermine par elle-même un tel niveau de contraintes politiques qu’elle entraînerait une crise fatale des structures de pouvoir étatiques ainsi que la ruine de l’économie sur le mode d’une prise sur le tas, dans un contexte d’effondrement civilisationnel et d’affrontement généralisé entre bandes.
Dans tous les cas, et en raison de son indétermination, ce moment populiste doit être compris dans ce qu’il a d’historiquement spécifique, en relation avec le présent du capitalisme ; et celui qui ne veut pas parler des conditions de vie actuelles de l’ensemble du prolétariat — parce qu’il préfère, par exemple, parler de sa propre exemplarité — devrait se taire à propos du populisme. Cela signifie qu’il faut saisir en même temps ce qu’est le populisme, et ce qu’est la politique du populisme.

De quoi le populisme est-il le nom ?
Référendums en France et aux Pays-Bas sur le traité établissant une constitution pour l’Europe en 2005 ; Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002 ; Brexit en 2016 ; Marine Le Pen au second tour en 2017 ; entrée de l’AfD au parlement allemand en 2017. Des partis populistes sont entrés au gouvernement en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne et en Bulgarie. En Finlande, en Espagne, au Danemark ou encore en Suède, des forces hostiles à l’immigration s’affirment sur la scène nationale. Cette tendance politique est désignée par les médias, le secteur de la recherche et le monde de la culture comme relevant du populisme.
Le populisme, nous dit-on, serait en deçà de la raison politique incarnée par l’État et ses représentants. Comme un emportement irrationnel, enfant de toutes les démagogies, son style est celui du menteur devant la plèbe. Ce fruit immonde de l’ignorance révèle les vils instincts des masses stupides et réfractaires au progrès. Voilà le pire mésusage de la démocratie. Une perversion populaire, un vice déplorable né d’une peur atavique de la nouveauté et d’une inaptitude coupable à s’y adapter. Le populisme fait bien sûr signe vers le passé. Les années 1930. Le fascisme.
Le populisme appelle par conséquent une réaction vigoureuse et ferme : des tribunes dans les journaux de référence, des mobilisations citoyennes, des fronts républicains. Sans doute faudrait-il également réformer la démocratie, rétablir une forme de suffrage censitaire, réserver le droit de vote aux plus diplômés, à ceux qui savent, selon les formules consacrées, s’ouvrir sur le monde sans avoir peur de l’Autre. Et d’impliquer la justice, sommée d’interdire les partis malfaisants. Lutter contre le populisme, c’est déjà se tenir du bon côté de la barrière, en compagnie de la raison, du progrès, de l’humanité, du Bien. C’est en somme une question morale, qui assemble les gens bons dans la condamnation unanime de ce fléau. C’est le combat qui opère le partage entre les gentils et les méchants. Une lutte qui comporte enfin deux caractéristiques intéressantes : premièrement la méconnaissance de la division de la société en classes, c’est-à-dire en fait de l’exploitation non pas comme injustice locale, mais comme structuration des rapports sociaux ; deuxièmement, la permanence de l’État dans le rôle de l’interlocuteur légitime des luttes et plus généralement de la politique.
Nous n’emploierons pas, quant à nous, populisme comme un terme accusatoire qui vise l’enfermement dans l’alternative entre d’une part l’état actuel des choses, tel qu’il est normalisé et rationalisé depuis des décennies dans le cadre des politiques néo-libérales, et d’autre part l’État conservateur et souverainiste – soit comme volonté de ne pas connaître les raisons de ceux qui portent cette tendance et qui se nomment eux-mêmes le peuple, au croisement des genèses politique, historique et nationale, ce même nom qui désigne pour nous la réalité d’une configuration inédite de la question du prolétariat.
Le nom de populisme doit donc s’extraire de l’usage moralisateur auquel certains voudraient le confiner, pour le destiner à la description d’un phénomène dont la compréhension nécessite une tout autre grille de lecture. Nous voulons montrer que le populisme ne peut être compris qu’en rapport avec le capitalisme et notamment comme produit de la restructuration et de la fin du compromis fordiste. Qu’il est d’abord le fait d’un rejet massif de la part du prolétariat non seulement des politiques mises en œuvre par la classe possédante, mais plus fondamentalement des conditions de vie qui lui sont faites sous le capital et du rapport social qui fonde celles-ci ; et que ce n’est que secondairement qu’un tel rejet est capturé, dans une mesure variable, par la classe moyenne et les possédants dans le cadre démocratique, lui conférant une dimension interclassiste ainsi qu’un discours axé sur le conflit de valeurs. C’est dire — et c’est là un point essentiel — que le populisme n’est pas réductible à sa manifestation électorale et idéologique. Celle-ci n’est en vérité que l’effet de surface, produit par les interventions opportunistes des entrepreneurs en politique, d’un mouvement qui intéresse le cœur des sociétés occidentales modernes, et dont le sens est fondamentalement anticapitaliste en ceci qu’il procède de l’impossibilité radicale et sans espoir pour le prolétariat de défendre ses conditions d’existence dans le cadre actuel.
En d’autres termes, nous posons que l’analyse du populisme, tel qu’il est construit à travers son actualité démocratico-parlementaire, demeure partielle et donc fausse si elle ne saisit pas en même temps la réalité d’une transformation du rapport social, dans le cadre d’une crise sans retour de la société occidentale.

Sociologie du vote
La lecture dominante du populisme comme phénomène irrationnel escamote la question de classe et le réduit à un conflit de valeurs — ce qui rassure les classes supérieures puisqu’elles y tiennent évidemment le beau rôle. Voyons alors comment la tendance populiste se manifeste sur le plan de la sociologie électorale à travers quelques exemples.
France
En 2017, 61 % des ouvriers qui se mobilisent au second tour de l’élection présidentielle ont voté pour Marine Le Pen. C’est le cas également de 67 % des travailleurs en intérim et de 54 % des chômeurs. Par rapport au niveau d’instruction, 52 % de ceux qui ont un niveau inférieur au bac, et 51 % des détenteurs d’un bac pro, ont choisi la candidate du Front national, de même que 48 % des Français qui ont un revenu inférieur à 1500 euros — tandis que parmi ceux qui gagnent plus de 5000 euros ils ne sont que 14 % dans ce cas[1].
Selon une étude datant de 2006 qui porte sur les jeunes qui votent pour la première fois, menée par le Centre de recherches politiques de Science po (Cevipof), 41 % de ceux qui ont une ascendance espagnole, 45 % pour les descendants d’Italiens et 50 % pour les Français d’origine portugaise, accorderaient leur vote au Front national. Chez les primo votants au chômage, toutes origines confondues, ce score monte à 60 %[2]. Lors des élections européennes de 2019, le Rassemblement national est arrivé en tête chez les ouvriers (40 %), les employés (27 %), les chômeurs (29 %) et dans toutes les catégories de revenus sauf chez les supérieures (revenu mensuel supérieur à 3 000 euros) où c’est la liste d’Emmanuel Macron qui l’emporte[3].
Si la mobilisation électorale des catégories populaires était aussi forte que celle de la classe moyenne et des bourgeois, le Rassemblement national serait en mesure, dès aujourd’hui, d’accéder au pouvoir. Rien ne permet par ailleurs d’affirmer que celui qui ne vote pas est moins populiste que celui qui vote pour un Le Pen, ou pour le Brexit. En réalité, la sociologie des abstentionnistes est la même que celle des électeurs des partis populistes. Plus encore, si le vote populiste manifeste un éloignement de la politique traditionnelle, il demeure ancré dans la pratique démocratique, ce qui n’est même plus le cas des abstentionnistes.
Allemagne
En Allemagne, l’Alternative für Deutschland (AfD), née pourtant d’une matrice libérale, prend la défense de l’État-providence, jusqu’à revendiquer le revenu minimum. Cette stratégie lui a permis de devenir le troisième parti avec 12,6 % des voix — mais le deuxième dans la partie orientale du pays — et d’entrer au Parlement. 19 % des ouvriers, qui en dépit de la croissance n’ont pas vu leur salaire augmenter, ont donné leur voix au parti populiste en 2017. En Allemagne de l’Est, terre de désindustrialisation massive, 26 % des hommes ont voté AfD, dans des circonscriptions où Die Linke réalisait autrefois ses meilleurs scores. En Saxe, lors des élections régionales de 2019, l’Alternative für Deutschland est devenue le deuxième parti, avec 27,5 % des voix, et 35 % chez les ouvriers[4].
Le phénomène migratoire a joué un rôle décisif dans cette poussée populiste. À rebours du conte médiatique sur l’ingénieur syrien débarqué en catastrophe sur les côtes grecques ou siciliennes, on admet aujourd’hui que le niveau général d’instruction des migrants arrivés en Allemagne est bas, et que des années de formation seront nécessaires pour leur permettre d’intégrer le marché du travail[5]. Dans le même temps, il manquait en 2018 des millions d’emplois dignement rétribués dans un pays qui voit les mini-jobs se multiplier[6]. Il y a également l’impact de la migration sur les logements bon marché. De fait, ce sont les catégories populaires — y compris des segments d’immigration plus anciens — qui sont les plus exposées aux effets indésirables du phénomène migratoire, notamment en ce qui concerne la valeur du parc locatif, les conditions de scolarisation et l’image du quartier. Raison pour laquelle on observe un roulement très important des habitants des secteurs à plus forte composante immigrée : ceux qui en ont les moyens s’empressent de les quitter. De même qu’en France, le vote populiste révèle la segmentation des couches populaires et leur recomposition : à Freiburg, 34 % des votants de l’Afd ont un passé migratoire[7].
Suède
La Suède n’est pas le premier pays auquel on pense lorsque l’on évoque la question sociale. Son système social apparaît solide et le taux de chômage semble contenu — il est cependant trois fois plus élevé chez les actifs nés à l’étranger[8]. On estime que ces dix dernières années, un million de personnes au total ont émigré en Suède — davantage, en proportion du nombre d’habitants, que dans tout autre pays européen —, et que la moitié des immigrés de la dernière vague n’ont aucune qualification, raison pour laquelle il n’y a que 5 % des postes de travail qui leur sont accessibles. Ces emplois se trouvent d’ailleurs souvent dans le secteur des services, où une connaissance basique de la langue est nécessaire.
C’est dans ce contexte que le parti des Démocrates de Suède, dont les origines le rattachent en partie au néonazisme, a connu une croissance rapide. Ce parti n’avait obtenu que 1,4 % des voix en 2002. Il entre au parlement en 2010 avec 5,7 % des voix, et atteint 12,9 % quatre ans plus tard. En septembre 2018, lors des législatives, il arrive en troisième position avec 17,6 % des voix. Sous l’impulsion de leur nouveau leader Jimmie Akesson, les Démocrates donnent à présent de l’identité suédoise une définition culturelle, attachée à une défense de l’État-providence. Au parlement européen, ils siègent avec les députés scissionnistes du RN (Les Patriotes de Philippot), ceux du Movimento 5 stelle et de l’UK Independence Party (UKIP). Le noyau dur de son électorat est formé par les hommes blancs de la classe ouvrière, parmi lesquels il est le premier parti avec 25 % des votes, mais les derniers résultats montrent un élargissement de son public en direction des femmes et de certains segments plus anciens de l’immigration[9].
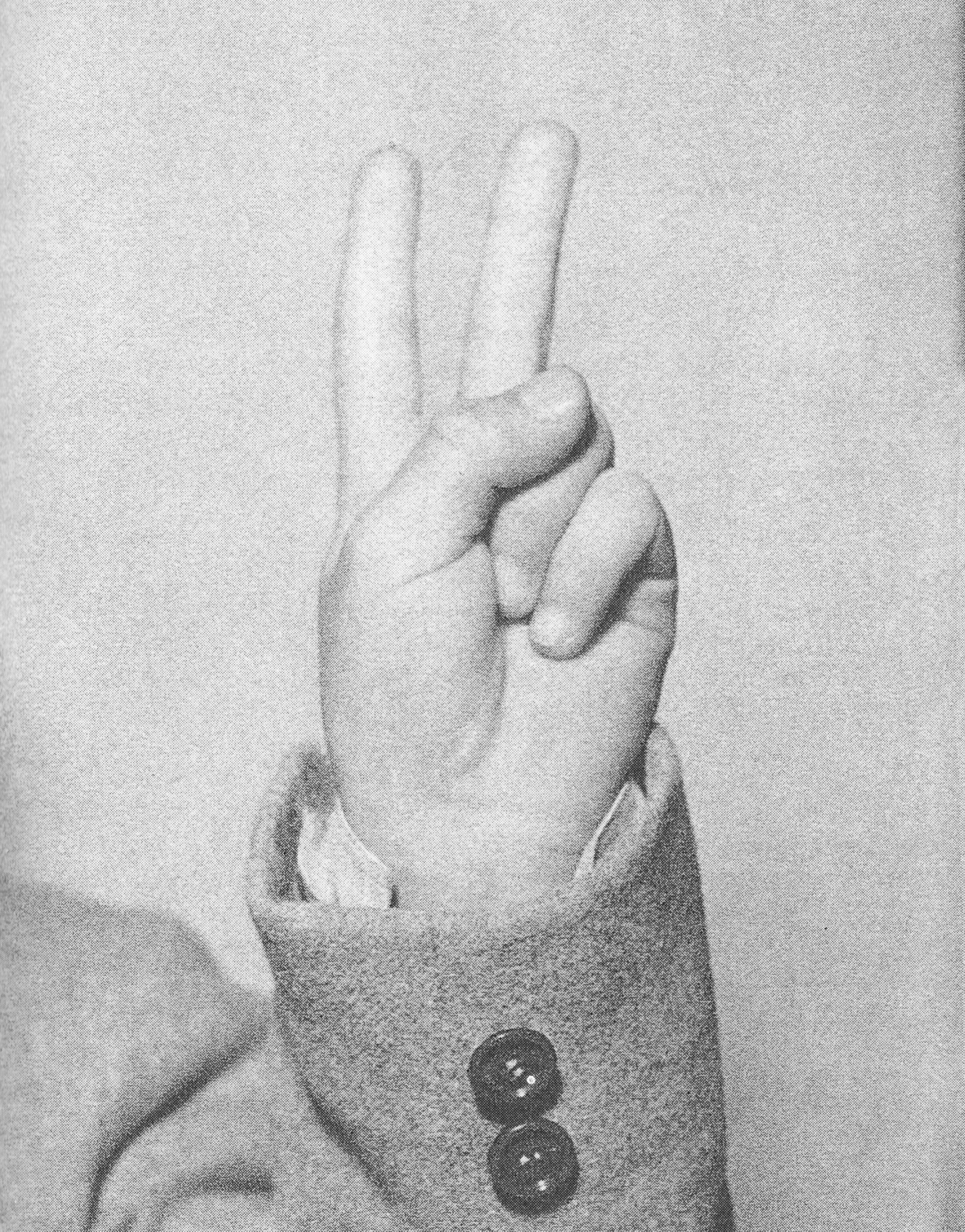
États-Unis
Aux États-Unis, le même déplacement des votes populaires, constaté dans les démocraties européennes, a permis la victoire de Trump. On sait que le revenu moyen de ses électeurs est supérieur à celui des autres candidats républicains, mais ce qui a déterminé sa victoire est surtout que beaucoup d’anciens électeurs ouvriers démocrates — notamment ceux qui vivent dans la Rust Bell — ont choisi l’abstention. Cela n’a pas empêché la classe ouvrière blanche de devenir subitement une catégorie à la mode, en tant que faire-valoir du progressiste libéral dans le rôle du gardien des valeurs humanistes. Pourtant c’est bien l’explication économique qui est la bonne : sur les 323 comtés où plus de 25 % des emplois dépendaient du secteur manufacturier, l’équilibre des votes démocrate et républicain s’est renversé. Il y a un quart de siècle, ils se répartissaient presque également entre les deux grands partis ; en 2016, 306 ont choisi Trump et 17 Clinton[10].
En vérité, la victoire de Trump masque un référendum sur les dernières décennies de la politique américaine, qui ont vu un accroissement inédit des inégalités, avec les 10 % les mieux payés qui captent désormais 47 % du revenu global. Le 1 % le mieux payé gagne 81 fois plus que la moitié des travailleurs la moins payée[11], tandis qu’un grand patron gagne en moyenne 347 fois ce que gagne un salarié de base[12]. On constate aussi que depuis 2008, pour la première fois depuis la guerre, le niveau de vie des catégories moyennes n’augmente plus, tandis que celui des plus pauvres a baissé. Il y a également un aspect générationnel : la richesse moyenne des personnes âgées de 30 à 39 ans (72 400 USD) en 2017 était de 46 % inférieure à celle dont disposaient au même âge les personnes âgées de 40 à 49 ans[13]. Et pour la quatrième année de suite, l’espérance de vie a diminué du fait de la crise des opioïdes – elle-même symptôme d’une crise sociale[14]. C’est donc l’abstention de nombreux oubliés du rêve américain, additionnée à la fidélité de la classe moyenne toujours loyale au parti républicain, qui a permis la victoire du milliardaire.
Royaume-Uni
Dans le nord de l’Angleterre, autrefois pôle industriel de première importance, 70 % des votants ont choisi le Brexit lors du référendum de juin 2016 sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne, tandis qu’à Londres, l’une des villes les plus riches du monde, ils n’étaient que 40 % à faire le même choix. La sociologie du vote est éloquente : 68 % des votants avec un degré d’instruction universitaire ont voulu rester en Europe, tandis que 70 % de ceux qui ont au plus un diplôme du secondaire ont choisi de quitter l’Union. Pour les élections parlementaires, on retrouve le même scénario qu’en Allemagne de l’Est : le nord désindustrialisé du pays, qui était une forteresse du Labour, a vu l’UK Independence Party (UKIP) arriver en deuxième position avec 27,5 % aux élections européennes de 2014 dans la circonscription du Nord-Ouest, et 29,2 % dans celle du Nord-Est[15].
En mai 2019, les élections pour le Parlement européen ont confirmé la tendance. Le Brexit Party de Nigel Farage, ancien leader de l’UKIP, dépasse les 30 % à l’échelle nationale. Dans les circonscriptions électorales anciennement industrialisées, les partisans de la sortie de l’Europe dépassent même les 40 %. À Londres, en revanche, ils n’obtiennent que 20 % des suffrages.
Italie
En Italie, suite à leur victoire lors des élections générales de 2018, deux partis ont formé une coalition gouvernementale : la Lega et le Movimento 5 stelle (M5S). Le premier était à l’origine un parti régionaliste exprimant la révolte fiscale des secteurs dynamiques de l’économie italienne, les PME du nord de la péninsule. Son nouveau leader, Matteo Salvini, est arrivé à la tête du parti quand ce dernier se trouvait englué dans divers scandales. Il a abandonné les références à l’indépendantisme pour transformer le parti en une version transalpine du Rassemblement national français. Cette stratégie a payé : aux dernières élections de mars 2018, le parti a réalisé 17,4 %, surpassant le parti de Berlusconi (14 %) et prenant de fait la tête de la coalition de droite. Le M5S, quant à lui, défend l’idée d’un revenu de base et trouve un appui massif dans la partie méridionale du pays où il dépasse, dans certaines provinces, 50 % des voix exprimées. Il a réalisé au niveau national le score de 32,9 %[16]. Chez les ouvriers, le M5S atteint 37 % des votes exprimés, contre 23,8 % pour la Lega.
Si on cumule les résultats pour les deux partis, 60,8 % des ouvriers, 55 % des chômeurs et 58 % des précaires ont voté pour la Lega ou le Movimento 5 stelle. Les plus jeunes ont massivement voté Movimento avec 44 % chez les 18-30 ans, et même 49 % chez les étudiants. La Lega réalise ses meilleurs scores parmi les chômeurs des zones historiquement centrales de l’économie italienne, la Lombardie et la Vénétie. La sécurité et l’immigration sont, de très loin, les thèmes les plus mobilisateurs pour les électeurs de ce parti[17]. En tant que ministre de l’Intérieur, où il a mis en application les mesures visant à limiter autant que se peut l’immigration, Salvini a touché des niveaux de popularité inédits en Italie, y compris dans le Mezzogiorno. Le thème de l’immigration est devenu incontournable dans l’actualité politique italienne et profite, plus que jamais, à la composante droitière du gouvernement : en septembre 2018, la Lega était donnée par les sondages à un niveau historique de 34 % et le M5S en recul à 27 %[18].
On le voit, les classes populaires se sont détournées de la gauche pour donner leur vote à des partis qui, s’ils ne sont pas toujours hostiles aux politiques fiscales qui avantagent les plus riches, sont en revanche toujours contraires à l’immigration et aux instances transnationales. Les causes de ce basculement remontent à la phase de restructuration qui a débuté dans le dernier tiers du siècle dernier.
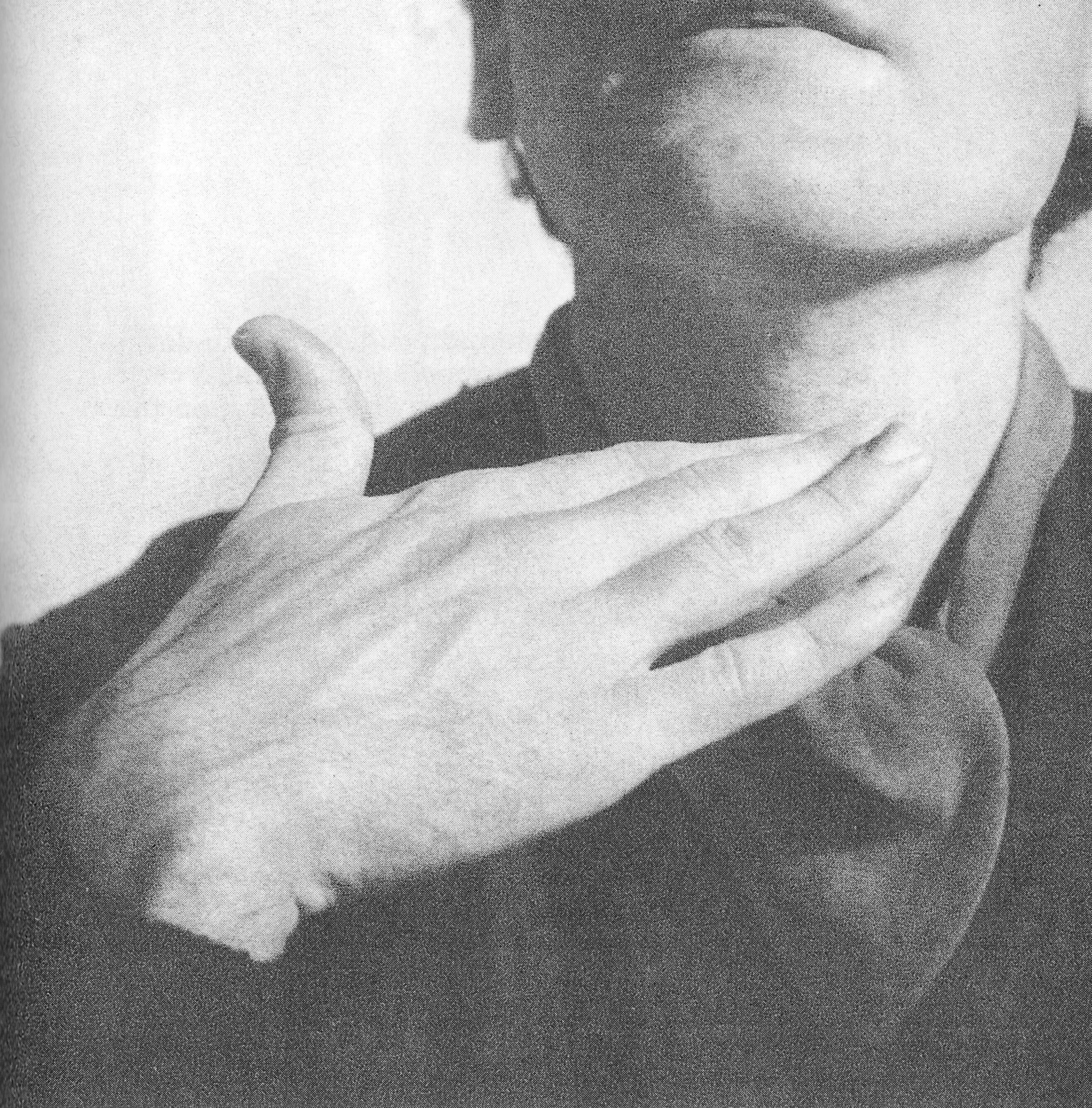
Restructuration
Jusque dans les années 1970, l’intégration des travailleurs dans la communauté de travail nationale attestait la force de l’identité ouvrière, liée à une représentation de l’avenir positive et à l’idée que les enfants vivraient mieux que leurs parents. Les principaux instruments d’une telle ascension sociale collective étaient l’éducation de masse et l’essor de l’industrie, tandis que l’État jouait un rôle central à travers une dépense publique considérable et par le contrôle des secteurs stratégiques de la production, de l’énergie et des transports. La constitution d’une force de travail de plus en plus spécialisée assurait l’ancrage durable dans la consommation abondante, ainsi que l’acceptation du jeu électoral avec la participation des partis communistes et sociaux-démocrates au régime parlementaire. Cette séquence historique tend à l’effacement des particularismes religieux et nationaux et à l’affirmation du prolétariat comme sujet monolithique correspondant à l’unicité de son programme.
Cette importance nouvelle de l’identité prolétarienne semblait donc inscrite dans le cours de l’Histoire, comme un produit logique du développement de l’industrie moderne. Cela se lisait en même temps comme la tendance du progrès à réaliser l’homme en tant que travailleur, et la classe des producteurs comme base d’une société promise à la richesse et à l’opulence. Conséquemment, une telle perspective appelait son organisation dans les formes du syndicat, des conseils ou du parti, autant d’instruments de sa visibilité ainsi que de son rôle décisif dans la question du progrès social. Le prolétariat était certes une classe exploitée, mais plus pour longtemps : fermement établi dans ses quartiers qui donneront aux villes industrieuses leur physionomie propre, sa place dans le rapport de production le constituait comme le champion de la justice qui allait enterrer tous les archaïsmes. Foin de la rente et de l’oisiveté, le travail deviendrait alors la communauté universelle. Le développement du capital se confondait avec l’émancipation du travailleur, et l’universalité de celui-là fondait l’internationalisme de celui-ci.
Un tournant
Le tournant majeur a lieu entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. En réaction à la baisse du taux de profit, en même temps que s’accumule une quantité énorme de capital qu’elle a de plus en plus de mal à valoriser, et sur fond de luttes ouvrières nombreuses et parfois très violentes comme ce fut le cas par exemple en Italie, la classe capitaliste procède au démantèlement de la grande industrie et à sa délocalisation, afin de réduire le coût du travail et sauver ses marges de profit. Cela entraîne une externalisation massive des activités à faible valeur ajoutée ainsi que le transfert de nombreux emplois vers le secteur tertiaire, en particulier vers sa partie informelle dont la condition d’accès est un salaire très souvent misérable. Les revenus stagnent voire commencent à baisser, ce qui provoque le développement du crédit et l’assouplissement des règles bancaires : la finance prend son essor vers l’intégration des circuits économiques sur grande échelle. À l’aube du XXIe siècle, la dette des ménages devient la source principale de la demande, signe d’une déconnexion de plus en plus grande entre revenu et consommation. Voilà posées les conditions des crises à venir.
Avec le recul de la grande industrie, un nouvel environnement se met en place, qui voit l’individualisation du procès de travail et de son contrôle devenir la règle. Cela est particulièrement visible dans les services à la personne, qui comportent une forte exigence de flexibilité et de mobilité géographique et professionnelle, ainsi qu’avec l’émergence de formes d’auto-exploitation intensive dans le micro-entrepreneuriat : le dérèglement de l’emploi du temps des plus pauvres est devenu un présupposé de la consommation abondante et qualitative des plus riches. L’essor du secteur tertiaire — dont profitent depuis toujours les possédants, et maintenant les fractions supérieures de la classe moyenne — avec sa multitude d’unités laborieuses plus ou moins auto-esclavagisées, forme ainsi l’envers de l’émiettement de la force de travail industriel anciennement regroupée non seulement sur son lieu de travail, mais également dans son habitat et ses lieux de consommation. Sur le plan territorial, le prolétariat va donc perdre la ville, et avec elle une part de la mémoire et de la richesse immatérielle que concentre l’espace urbain ; elle est en effet devenue trop chère, et ne garde dans ses murs qu’une fraction de la nouvelle domesticité des services, recrutée dans des populations récemment immigrées.
La dérégulation et l’unification des marchés construisent un cadre concurrentiel plus dur, qui accélère la modernisation de l’appareil productif et provoque en retour l’obsolescence de plus en plus rapide des savoir-faire cumulés par le travailleur. Au métier succède la fonction, et fatalement la morale de celui-là cède à l’incompétence dans celle-ci. Cette logique consacre le rôle de l’expert, de la tête bien faite sortie des grandes écoles, et plus généralement la qualification aux dépens de l’expérience. La rationalisation au service de la productivité amène également la modélisation des relations de travail selon l’ingénierie managériale, et l’introduction incessante de nouveaux modules de fonctionnement pour les équipes et la généralisation des flux tendus. Le contrat de travail précaire devient la règle, tandis que la distinction entre emploi, formation et chômage tend à s’effacer.
Quant au progrès dans l’automation des tâches, il entraîne la disparition de nombreux emplois d’exécution, renforçant de ce fait l’importance des diplômes et de l’instruction supérieure comme moyen de se protéger de la mise au rebut[19].
Ce sont les grandes années du néolibéralisme, avec le triomphe de l’idéologie du mérite et de la responsabilité individuelle. La condition d’ouvrier ou d’employé apparaît en retour comme un échec personnel, un surplace honteux à l’heure où la révolution numérique exige un renouvellement rapide des compétences. Cette méritocratie s’illustre dans la course aux diplômes, la chasse aux bonnes filières, la planification stratégique des parcours scolaires dès la maternelle, la prolifération des farces et attrapes de la psychologie positive, le souci permanent de sa propre employabilité et la mise en scène de plus en plus outrageusement mensongère des apparences de cette employabilité. Ce régime de mobilisation intensive, où la moindre promenade en forêt avec tante Annabelle doit prouver votre aptitude au happy management, a son envers dans la figure du neet — Not in Education, Employment or Training — ces jeunes et moins jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, et qui parfois renoncent à chercher du travail. Le règne de la trivialité quantitative produit à la fois des existences surmenées jusqu’à la mort et des grèves solitaires permanentes : karoshi et hikikomori, les deux bornes lugubres de la non-vie sous le capital.
Le chômage de masse s’installe et bien évidemment, ceux qui succombent sur le front de l’emploi sont les mêmes qui sont à la peine dans la compétition scolaire. Rappelons qu’en 2014, 55 % des Français âgés de moins de 34 ans ne sont pas diplômés de l’enseignement supérieur[20]. Les lamentations sur la dévalorisation du diplôme et la crise de l’autorité à l’école ne doivent pas faire oublier que les vrais perdants du cours actuel, ce sont les non-diplômés, autrement dit les enfants des milieux populaires : les déclassés cachent les non-classés[21].
Ce vaste procès de restructuration va pousser la productivité à des niveaux inédits, aux dépens des interstices qui ont permis, autrefois, d’élaborer une relation personnelle et collective supportable à l’activité salariée. Dans ces conditions qui génèrent souffrances et maladies, le roulement du personnel devient de plus en plus rapide, empêchant la sédimentation dans l’entreprise d’une mémoire des luttes et la création de liens de solidarité. Les organisations ouvrières font face à une désaffiliation massive et, par un effet de renforcement circulaire, l’affaiblissement des instances de représentation collective de la classe ouvrière conduit à un affaiblissement de la conscience de classe, qui à son tour rend le travail de représentation de la classe ouvrière de plus en plus difficile, donc à court terme, de moins en moins rentable politiquement[22].
La délégitimation de la revendication salariale finit par rendre le prolétaire étranger à son propre monde, provoquant son retrait de la politique et en général de toute forme de participation à des collectifs ou associations. Elle aboutit au repli sur la sphère du privé, en conformité avec l’individuation méritocratique des destins : les questions posées par l’obsolescence de la force de travail se transforment en problèmes personnels, et appellent par conséquent des réponses d’ordre administratif — pour surveiller et punir —, et médical — pour remettre en état de marche la carcasse humaine du travail vivant.

Fin de l’identité ouvrière
Cependant la restructuration n’engendre pas la fin du prolétariat, mais bien la fin de l’identité ouvrière — la fin de son existence politique ainsi que sa dislocation culturelle et symbolique. Aujourd’hui encore, en France, ouvriers et employés représentent environ 50 % des actifs[23], mais l’appartenance à la classe ne trouvant plus son sens en elle-même — soit dans le rapport antagonique avec le capital qui la confirmait dans sa nécessité historique — elle commence à s’effacer peu à peu. Cette dépolitisation produit en retour une ossification de l’existant, où tout ce qui est posé par le capital jouit désormais d’une évidence indiscutable et normative. La défaite historique de la classe des producteurs constituée en sujet collectif construit ainsi un nouvel état de nature, avec ses lois cruelles : le prolétaire devient l’invisible, la force de travail qui ne sert bientôt à rien, le travailleur démonétisé. Il est le surnuméraire, l’enfant malheureux du divorce entre valorisation et reproduction de la force de travail, le retardataire qui a manqué le train de l’histoire et perdu de vue les premiers de cordée. Le progrès génère ainsi ses estropiés. Ce sont ces figures ringardes du plouc et du bidochon, les déplorables de Madame Clinton, ces fossiles sociologiques méprisés, habitants sédentaires d’un monde déjà ancien où toutes les minutes de la journée n’étaient pas au service de la croissance.
Croyant en avoir fini avec la vieille taupe, la bourgeoisie possédante a entamé son long monologue sur les vertus du marché, et le monde s’est transformé en royaume du mépris de classe. On s’étonna d’abord que le mouvement ouvrier ait pu exister et exalter, partout dans le monde, l’aptitude de l’humanité à former, même écrasée sous le talon de fer de la propriété organisée, les plus beaux rêves de liberté. À l’étonnement devant cette histoire succéda l’effort pour la réécrire sous son jour le plus noir, à traquer dans ses moindres détours les calculs égoïstes et intéressés auxquels nul ne saurait déroger aujourd’hui, sous peine de se déclasser dangereusement. Et finalement à la faire oublier, comme si le progrès de la domestication ne souffrait de contestation autre qu’absolument aberrante, voire indiciblement criminelle. Seules des catégories qui ne convoquent plus l’exploitation et la société de classe comme cadre d’analyse, ainsi les pauvres et les exclus, les victimes, pourront désormais être admis à l’attention paternaliste de l’État. C’est la consécration de la démocratie comme règne de la quantité éternellement impuissante à devenir qualité. (Bordiga) Cette même impuissance sera célébrée par les intellectuels du pouvoir comme une vertu anti-totalitaire.
Peu à peu, le prolétariat va disparaître de la mémoire collective, au profit de la classe moyenne. Station terminale des tumultes sociaux et idéologiques, cimetière des projets universels d’émancipation et des grands récits, la classe moyenne a vocation de s’élargir aux dimensions d’une humanité épanouie dans la condition salariale. Elle est le lieu où l’administration des choses tient la place qu’occupait jadis le gouvernement des hommes. Son visage le plus caractéristique est celui des travailleurs qualifiés de l’économie numérique, jeunes et voués à des tâches qui n’existaient pas il y a vingt ou trente ans. Ils s’imposent dans le décor urbain comme les prescripteurs d’une nouvelle discipline des corps et des esprits, dans une recherche constante de la performance utile à la compétition interindividuelle qui va bientôt englober tous les aspects de l’existence. Cette nouvelle population branchée et nomade donnera le départ à l’embourgeoisement des quartiers populaires. Voici venue l’heure du cadre dynamique, de l’ingénieur IT et du créateur de start-up comme modèles de citoyenneté et de tolérance.
La restructuration comme conservation du pouvoir entre les mains de la classe possédante aura donc entraîné, d’une part, la défaite du prolétariat, son occultation politique et sa constitution en objet de mépris. Elle détermine l’inactualité de la révolution dans la forme où elle se proposait — soit comme libération du travail et autogestion généralisée[24]. D’autre part, elle consacre l’hégémonie idéologique et culturelle de la classe moyenne, c’est-à-dire de tout le personnel qui, en plus de produire ou faire circuler la valeur, intervient à tous les niveaux pour que la production et la circulation se déroulent de façon fluide, sans à-coups ni interruptions[25].
Et la révolution ?
L’impossibilité de l’affirmation de classe dans le cadre réformé de la reproduction du capital n’a pas déterminé, du moins pour l’instant, un rejet de la condition prolétarienne elle-même. Il y a bien eu des conflits qui ont dépassé le contexte de l’entreprise et qu’il ne fut pas possible d’inscrire entre les bornes de l’emploi et du salaire, et semblant de ce fait en rupture avec le cours habituel des luttes. Mais les émeutes caractérisées par la destruction des moyens de production, ou de leur détournement massif, demeurent des exceptions qui confirment la règle : loin de marquer le départ d’un mouvement mondial où le capital variable serait contraint de s’abolir par l’impossibilité de s’affirmer comme tel, les luttes non revendicatives témoignent plutôt des accélérations brutales de la désintégration salariale et des résistances parfois spectaculaires que celles-ci rencontrent, sans pour autant changer son résultat.
Cela étant, avec le recul de bientôt un demi-siècle, il est devenu manifeste que la restructuration produit l’appartenance de classe comme une contrainte extérieure, et qu’elle oblige par conséquent à reconsidérer le communisme aussi bien dans son contenu que dans ses formes d’actualisation. La restructuration amène aussi à reformuler la solution au problème de l’existence du prolétariat, tel que :
- son abolition comme pratique révolutionnaire, par où il s’abolirait sans transition entre le capitalisme et le communisme,
- sans médiation sous la forme de parti, de conseils ou d’une nouvelle démocratie,
- sans poser son autonomie en face de ses conditions de vie, c’est-à-dire sans présupposer ce que seront ses objectifs ni fétichiser ses besoins « immédiats » ou « radicaux »,
- sans le secours d’aucune nature révolutionnaire, le communisme étant déterminé dans les conditions présentes par des facteurs matériels,
- sans réaliser un autre mode de production, le communisme étant le dépassement de la séparation de l’existence avec ses moyens de reproduction — soit la fin de l’économie.
En bref, la considération des termes actuels de la question du communisme permet de cocher correctement toutes les cases du bilan critique des révolutions ratées.
Mais justement, si l’emboîtement de la théorie du communisme avec la science des échecs prolétariens antérieurs fonctionne de façon si admirable, c’est parce qu’il part de son résultat et procède à rebours, en escamotant dans le présent tout ce qui pourrait préfigurer un autre devenir. Il ne pourrait ainsi y avoir d’autre dépassement que celui qui a été identifié comme nécessaire par les théoriciens communistes – nécessaire parce que téléologiquement conforme à ce que peut et doit être le communisme pour correspondre à sa définition actuelle. Nous devons au contraire imaginer en même temps le nouveau cadre de compréhension qu’impose la restructuration, et le fait que cette nouveauté détermine possiblement, par elle-même, les conditions d’un nouvel échec historique. Par exemple en jetant les hommes sans qualité, que la contradiction en procès relègue au ban de la vie dignement vécue, dans la recherche d’une autre communauté d’appartenance.

La désintégration comme échec de la moyennisation
Ce qui se joue à présent, après l’échec du mouvement ouvrier et du travailleur en tant que membre d’une classe appelée à prendre la relève de la bourgeoisie, c’est donc la constitution d’un nouveau collectif, lequel va conférer un autre contenu à l’antagonisme avec le rapport hégémonique. Car au-delà de la saisie révolutionnaire du pouvoir, il s’agissait bien dans le cas du prolétariat organisé d’une identification à la bourgeoisie et à son projet de libérer l’homme de tous les carcans qui l’enserrent, pour qu’il puisse enfin manœuvrer rationnellement la production selon le meilleur intérêt de tous. Ce qui n’était pas remis fondamentalement en question, c’était une forme spécifique d’intégration sociale, en fait l’économie développée, qui ne saurait tolérer que provisoirement les appartenances ethniques et culturelles. Le mode de vie consumériste — l’american way of life — condamne en effet les liens et les croyances hérités des générations précédentes, embourbées dans les horizons bornés et les paysages immobiles du travail artisanal couplé à la petite propriété, à un déclin irrémédiable, tandis que la socialisation opérée sous le capital, qui engendre des formations sociales de plus en plus vastes, de la Cité marchande à l’Empire en passant par l’État-nation, apparaît visiblement comme le devenir universel de toutes les socialisations existantes, et donc comme la consécration de l’individu échangiste, de ses besoins naturels, de ses droits et de la liberté comme idéologie implicite de la marchandise. Et il est vrai que la bourgeoisie a refait le monde à son image, en sapant les bases de tous les rapports personnels de dépendance intriqués dans la tradition et la coutume, pour ne laisser subsister que la science économique et son objet qui est l’économie. Résultat de cette réduction au commensurable, l’argent s’est constitué en nouvelle communauté de tous les hommes par-delà leurs différences : ce mouvement, dans sa dimension phénoménale, constitue la base objective de ce qui a été appelé le progrès.
Mais la succession de crises depuis la fin des Trente glorieuses a ensuite prouvé l’inanité du mythe de la moyennisation. Avec la désintégration du prolétariat, du fait de l’incapacité pour le capital à reproduire toute la force de travail disponible, il ne demeure que la partie haute de la société qui conserve la perspective progressiste, trouvant dans les marchés et plus fondamentalement dans la logique d’accumulation, le ressort de son cosmopolitisme. Ce segment privilégié de la population opère donc son unification mondiale par le haut, avec une bourgeoisie transnationale en poisson-pilote. Celle-ci représente naturellement sa société comme étant la seule société possible.
Dans le pôle dominé du rapport d’exploitation, en revanche, l’échec de la socialisation capitaliste défait l’inclusion dans la consommation abondante et ses modes de vie exemplaires grâce auxquels on peut s’y distinguer. Désormais, le zonage mondial des aires de production et de circulation — qui ne recoupe pas les frontières nationales — pérennise l’existence d’immenses populations désœuvrées survivant aux marges des villes mondialisées. Loin de recommencer en Chine ou en Inde le chemin parcouru en Europe, le cours actuel entraîne des portions de l’humanité directement de la pauvreté paysanne à la misère (péri -)urbaine, c’est-à-dire d’un monde où il y avait peu d’argent à un monde où il n’y en aura jamais assez.
De même, dans les métropoles occidentales, la restructuration signe le début du décrochage des classes populaires — phénomène qui a connu récemment une accélération notable avec la crise des crédits hypothécaires. Une strate après l’autre, des segments du prolétariat et bientôt de la classe moyenne voient leurs conditions de vie se stabiliser puis régresser. S’il n’y a plus d’étrangers au capitalisme — à part peut-être au fond de l’Amazonie ou sur quelques îles de l’océan Indien — commence en revanche une production d’énormes cohortes incomplètement socialisées, pour qui la débrouille au jour le jour, le tout petit commerce et les prestations de service informelles dessinent le visage modernisé de la survie. Cette précarité ne forme en aucun cas un mode de vie alternatif, un monde commun, ni même une contrainte à être révolutionnaire ; il n’y a du reste aucune pratique prolétaire qui soit communiste en soi.
Une appartenance nouvelle
La fin du monde ouvrier, et aussi de toutes les sociétés qui n’auront même pas connu une phase de prolétarisation classique avec l’industrialisation, pose ainsi la question de l’appartenance nouvelle, c’est-à-dire de la restauration du lien social comme somme de rapports entre les individus, rapports auxquels l’argent ne suffit plus à donner une forme. Une appartenance à même de protéger contre la violence de l’échange, cette violence qui entraîne la déchéance matérielle, personnelle et collective, morale et symbolique, la sédentarisation forcée ou l’exil vers d’autres esclavages. Une appartenance avide de tout ce qui peut densifier une identité partagée, la blinder, l’enraciner et l’essentialiser. L’appartenance, finalement, comme condition et gage d’une solidarité permettant de casser les verdicts de nullité et d’inutilité prononcés dans l’économie. Les conditions d’existence qui découlent de la disparition de l’emploi et de la destruction de la professionnalité, donc dans la crise sans remède du statut social, appellent ainsi un renforcement des relations personnelles, seule base matérielle possible de la survie.
Un regard sur le passé enseigne que le prolétariat n’aura guère longtemps fait partie de la société où le développement de l’échange marchand remplace le rapport personnel manifeste, pas assez longtemps en tout cas pour que son éjection puisse se voir conférer la dignité d’un enjeu historique majeur. Nous assistons au retour de moins en moins discret d’un état d’existence extérieur à la société, un en-dehors, que certains facteurs liés aux colonisations et aux reconstructions d’après-guerre ont aidé à surmonter, en Occident, au cours des deux derniers siècles. Le même phénomène tourne en revanche au drame lorsqu’il concerne la classe moyenne, car ici il touche ceux qui ont les moyens de faire connaître leur malheur et de le constituer en problème de société. Alors seulement se rend visible la fragilité historique de l’individu échangiste et de l’organisation démocratique qui régente l’exploitation sous les apparences de la paix sociale, tandis que se renforce la crainte que tout cela soit balayé quand se lèveront à nouveau les vents de la crise et de la guerre.
En attendant que la panique gagne la classe moyenne, dans l’état de barbarie naissant, la solidarité exclusive et son ombre identitariste ont déjà parcouru un long chemin. On bricole des liens essentiels à la survie comme on peut, localement, à partir du territoire qui seul demeure familier, avec ce qu’il reste des marqueurs culturels et ethniques passés à la moulinette de la restructuration ; la dimension contrariée de l’appartenance de classe tend à se transcender dans une communauté qui cependant ne perd pas complètement sa détermination sociale. En effet, si en vertu du racisme de classe, la culturalisation des surnuméraires les produit comme étrangers dans le monde de l’abondance, les aires de la richesse circulante et de ses habitants solvables — comme les quartiers de l’Ouest parisien avec ses grandes avenues, ses palais du pouvoir, ses établissements de luxe — apparaissent logiquement en retour, à une part croissante du prolétariat, comme des territoires hostiles peuplés de gens aux préoccupations de plus en plus déconnectées de la réalité.
Gérer une ville et sécuriser l’espace public, ce sera de plus en plus faire en sorte que ces mondes ne se croisent pas, car il suffit de peu pour que la rencontre dégénère en violences : la fiction du citoyen et de sa sujétion à l’État, avec le respect de l’autorité qui en découle, n’est tenable qu’à la condition que l’on puisse, à travers l’échange, prendre sa part du spectacle ; la consommation demeure le palliatif universel à la déqualification des rapports sociaux et de l’activité. Quand même la redistribution sous forme d’allocations et de service public est entravée par les politiques de rigueur, c’est-à-dire par les politiques exigées par les grands capitalistes, cela aboutit à la création d’un territoire de personne, qui se construit comme l’envers du global village : la lutte de classe devient la lutte de ceux qui sont d’ici contre ceux qui ne sont de nulle part. Il est souvent dit des gens qui passent beaucoup de temps dans les aéroports qu’ils ont tendance à se sentir partout chez eux. Ceux qui au contraire ne jouissent pas ou plus du privilège de la mobilité choisie se sentent chez eux là où ils endurent la survie, et sans doute ce serait encore plus dur si ce n’était plus chez eux.
Il n’y a rien, dans la société actuelle, c’est-à-dire sur la base des contradictions que le capital ne peut plus surmonter dans un cadre démocratique, qui puisse combler l’écart qui se creuse entre l’humanité vertueuse embarquée dans le progrès objectif et la masse grandissante des surnuméraires. Et voilà pourquoi nous n’avons pas fini d’entendre parler du peuple.
Le peuple
On le voit, le populisme est d’abord une tension à la communauté qui s’origine dans la situation actuelle du prolétariat. Il découle des privations matérielles et de leur impact sur le plan de la subjectivation, après que la restructuration a placé le prolétariat dans un face à face immédiat avec la classe capitaliste. Il n’y a plus aucun intermédiaire, rien qui permette d’encadrer le conflit par des rituels convenus dans les périodes de paix sociale. Surtout, il est impossible pour les travailleurs de se défendre collectivement en se repliant, comme jadis, sur les formes d’associations antérieures à la subsomption réelle. Toute reproduction de la classe et de ses moyens d’existence ne dépend désormais que d’une conjoncture locale, déliée de toute considération d’un intérêt supérieur au rapport de force entre travail et capital. Si le populisme présente une dimension anti-politique au sens de rejet de la politique menée par des fonctionnaires que les grandes entreprises prêtent à la politique, il est en revanche le nom du retour du politique. Ce retour s’ancre dans la nécessité pour les surnuméraires de reconstituer une raison supérieure à l’économie. Ils savent que le propriétaire d’une force de travail qui ne se vend pas n’est socialement rien du tout, et comme tel toujours susceptible d’être éliminé d’une société où la source de la légitimité sociale réside dans la performance mesurable.
Toutefois les vieilles formes communautaires où l’échange n’était pas hégémonique sont irrémédiablement perdues, et personne ne détient la recette pour nier ou encastrer l’échange dans une forme sociale immunisée contre l’infinitude de l’accumulation. Cette limite constitue l’impossibilité d’une politique proprement populiste, c’est-à-dire son échec prévisible dans la coexistence avec l’État et sous la direction de la classe possédante. Il n’en demeure pas moins que le populisme procède de la crise de la reproduction de la force de travail dans sa totalité, c’est-à-dire pour toutes les classes et dans le monde entier. En lui se manifeste l’indétermination du présent, avec le durcissement des luttes où il n’est pas possible de lire autre chose que la fin d’un sujet politique, classe ou parti révolutionnaire, et la survivance d’un rapport social spécifique, basé sur l’équivalence abstraite, sur l’abstraction des qualités sensibles, lesquelles font violemment retour ; mais ce retour n’est pas saisi dans le rapport à ce qui l’a provoqué, et c’est pourquoi il est interprété trop souvent comme relevant d’une problématique qui n’intéresse pas le capitalisme en soi, mais plutôt l’idéologie de l’ordre établi[26].
La raison du populisme se déploie bien plus largement que dans les conflits du travail. C’est un destin partagé qui incombe, au-delà du travailleur isolé, à des générations de travailleurs, à leurs familles, aux voisinages – le voisinage général et plurigénérationnel des chômeurs et des travailleurs, des marges et du prolétariat, du bloc démographique majoritaire et des immigrés. Ces effets transcendent les relations de travail pour impliquer la totalité des rapports sociaux et des idéologies qu’ils sous-tendent. Cela se passe dans cet environnement proche, le réseau d’interconnaissances, comme espace intime et privé, dans la forme d’une collection toujours recommencée de liens personnels et affectifs, vies et solidarités précaires vécues sous la menace constante de l’accident de parcours, de l’isolement et de la dépression.
Le nom de la communauté d’expérience de la domination de la bourgeoisie — quand celle-ci ne sait plus que faire d’une force de travail devenue pléthorique — se dit dans la langue du populisme le peuple, qui n’est autre que le prolétariat dans ses conditions actuelles de déshérence : la confiscation de l’alternative et l’extinction de l’espoir d’un autre monde, autrement dit d’une autre manière de créer de la richesse et d’en jouir, entraînent l’avilissement du conformisme et remplit de honte ceux qui ne savent plus comment habiter le présent. Du fait que cette communauté d’expériences ne peut se donner une forme d’existence politique, elle demeure soumise à sa déformation politicienne caractéristique : c’est là qu’elle est neutralisée, que son mouvement est plié aux intérêts de certains segments de la classe moyenne, selon des configurations qui changent en fonction des spécificités nationales — plus ou moins de conservatisme, de libéralisme, de souverainisme, etc. Il y a donc une capture politicienne du peuple, qui soumet ce dernier aux raisons elles-mêmes contradictoires de la domination, et c’est ce qui achève l’invisibilisation du prolétariat.
Si l’on tient la classe ou le parti ou la lutte des classes comme le sujet révolutionnaire ou comme la révolution en devenir, alors il n’y a de peuple que chimérique et le rôle de la théorie serait ici de dénoncer la chimère. Si en revanche l’époque permet de voir ce sujet ou ce devenir comme un mirage, ou comme un écho de ce qui a été et qui n’est plus, alors le peuple, ou la multitude de peuples, peut être le nom actuel du devenir, et la virtualité d’une appropriation historique qualitative, en rupture avec l’insensé d’une production infinie sous laquelle nous avons été arrachés en masse à toute appartenance. Le nom de peuple dirait dans ce cas la difficulté à naître d’un rapport social inédit, cette communauté d’après l’économie qu’appelle la désaffiliation de masse, et dont le procès constitutif ne se manifeste pas comme une rupture révolutionnaire.
C’est finalement la réponse des classes moyennes et possédantes à un tel procès qui se donne dans ce qu’il est convenu, à ce niveau politique, de nommer le populisme. Ce dernier s’incarne dans les discours et pratiques qui opposent l’État aux instances supranationales, défendent la souveraineté populaire et l’inviolabilité territoriale contre les dynamiques du marché planétaire ainsi que contre les mouvements migratoires provoqués par l’intégration inégale des sociétés dans la hiérarchie mondiale de l’accaparement des ressources.

La politique
Le séparatisme des propriétaires de la société
La situation actuelle rend évidemment sensible à une offre de protection, qui met en valeur des structures propres à imposer des limites aux changements dont le cours ne profite qu’aux classes les mieux dotées en capital économique et culturel. En d’autres termes, une partie du prolétariat adhère à une politique qui, d’une manière ou d’une autre, veut encadrer la dynamique qui a présidé à la fin de la représentation sociale, politique et culturelle du monde ouvrier. C’est dans ce créneau que se situent des partis qui s’inscrivaient à l’origine dans une matrice explicitement néolibérale — comme le Front national des années 80, ou l’AfD aujourd’hui — et qui vont de façon opportuniste infléchir leur programme dans un sens plus social, jusqu’à capter une bonne partie de l’audience dont jouissaient autrefois les partis de la gauche. Cette double tendance creuse un écart socio-économique entre des électorats que l’on pourra ainsi distinguer de plus en plus nettement, écart qui se développe en une polarisation des discours sur les valeurs et choix sociétaux.
Cette politique visant à se protéger des effets néfastes de l’intensification des échanges provoque en retour la séparation du haut, visible dans la grande bourgeoisie ainsi que dans certaines fractions de la classe moyenne supérieure. De plus en plus, les propriétaires du salariat mondial abandonnent toute fiction de monde commun : réduction de l’appareil étatique aux seuls organes de défense militaire, de renseignement et de répression, ainsi qu’à certains secteurs industriels stratégiques étroitement imbriqués aux intérêts des fractions dominantes de la grande bourgeoisie ; mépris et ignorance des résultats des consultations populaires ; indifférence aux conséquences sociales de la catastrophe écologique planétaire ; circuits exclusifs pour la scolarité et la formation des enfants ; repli dans des communautés closes et surveillées par des milices privées ; démantèlement ou privatisation de tous les espaces où opère, un tant soit peu, un brassage social ; projets de migration vers la Nouvelle - Zélande et d’autres territoires supposément préservés de l’effondrement à venir, en attendant un futur établissement sur la Lune, sur Mars, ou en orbite dans l’espace comme cela a été anticipé par la science-fiction. Toujours plus distantes des masses désœuvrées, toujours plus rétives à la compréhension des formes d’attachement à un monde connu avant restructuration, qu’elles regardent désormais comme un univers stable et sécurisant, c’est-à-dire réactionnaire, les élites se trouvent piégées dans leur propre mythification du progrès, qui se confond de façon si visible à présent avec la légitimation de leur pouvoir.
La classe moyenne
Entre mille horreurs, le capitalisme nous donnera peut-être à voir une flotte de navires spatiaux de luxe entièrement robotisés, à l’usage des richissimes propriétaires qui quitteront ce monde quand ils l’auront jugé définitivement inhabitable. Ce sera le chapitre final de la phase progressiste de la marchandise, l’apogée du capital qui aura définitivement clivé l’humanité : l’avenir alien pour les enfants gâtés de l’accumulation, et l’aliénation sans avenir pour tous les autres, y compris pour les ingénieurs accélérationnistes de gauche. Car il n’y aura évidemment pas de place à bord des croiseurs interstellaires pour toute la misère du monde. Bloquée sur terre entre la piste cyclable et son bac à spiruline, la classe moyenne sera brutalement confrontée à des multitudes de chômeurs et de précaires qu’elle méprise autant qu’elle les craint.
Nous avons vu comment la restructuration entraîne la fin de l’identité ouvrière, la crise de l’appartenance et l’impossibilité pour le prolétariat de se penser historiquement comme une classe en mesure de réaliser le passage d’un mode de production à un monde sans classes. L’envers de ce déclassement, c’est donc la primauté de la classe moyenne dans la représentation. Celle-ci va escamoter la crise de la reproduction du rapport social — potentiellement explosive — derrière un conflit de valeurs. Non pas qu’elle le fasse à dessein, comme si elle était dotée collectivement d’une intelligence de son époque si grande qu’elle pourrait former le projet de neutraliser abstraitement cette crise, mais parce que de par sa situation hégémonique dans la sphère idéologique, il n’y a rien qui puisse s’y passer qui ne suive la pente de ses intérêts. D’où l’évacuation de l’histoire et ses tumultes. La tendance populiste est donc saisie dans les termes d’un examen moral et culturel, sous le prisme normatif d’un relativisme qui dérive de l’échangisme généralisé où tout est en relation exclusive avec le prix des marchandises : rien n’a de valeur, tout a un prix. En définitive, le politique se dégrade au rang d’un mauvais choix de société qui s’oppose à un bon choix de société. Tout doit être mesuré selon le degré d’adhésion aux modes de vie apparus avec la nouvelle classe moyenne, qui est la classe historiquement conforme aux lois du réalisme capitaliste.
Mais ainsi que nous l’enseigne l’offre abondante des marchandises culturelles — de l’atelier de théâtre (subventionné) en non-mixité à la revue néo-réac — la classe moyenne est hétérogène, et c’est donc en ordre dispersé qu’elle va chercher à s’instituer en représentant vis-à-vis de l’État, formant ainsi le lieu de rémanence d’un clivage gauche/droite parfaitement discrédité dans le prolétariat : plus ou moins de marché (plutôt plus), plus ou moins de libéralisme sociétal (plutôt plus). Relativement protégée par son niveau de qualification, elle demeure aussi la principale bénéficiaire des transferts de ressources par voie de redistribution ou d’héritage. La démocratie directe lui plaît davantage dans la forme de l’exercice de ses propres vertus civiques et citoyennes (horizontalité, respect de la parole, réflexions et débats, etc.) que dans les contenus qu’elle serait susceptible de comporter si elle devait échoir entre les grosses mains d’un ouvrier qui possède une télévision (le rétablissement de la peine de mort, le durcissement des lois sur l’immigration, le retour des frontières, etc.). Nonobstant le traitement prioritaire de ses préoccupations par les partis de gouvernement qui en ont fait leur clientèle exclusive[27], son rapport à l’État est critique : il a failli à sa mission qui est d’assurer une plus juste redistribution ; mais du coup, s’il est le problème, il est également la solution. Cette politique de la classe moyenne, qui est en fait la politique dans les démocraties occidentales, pose finalement la réforme de l’État comme seul horizon : où trouver des dirigeants probes et accessibles aux critiques de la « société civile » et des experts ?
L’essor, partout en Europe, de coalitions transversales visant à empêcher l’arrivée au pouvoir des partis populistes montre cependant que la classe moyenne sait dépasser ses divisions quand les circonstances l’exigent. L’alternance entre gauche et droite de gouvernement se transforme alors en un parti de l’alternance unique, basé sur un consensus fondamental, inscrit dans l’intérêt de classe, entre les possédants et une partie plus ou moins grande, selon les pays, de la classe moyenne. En France, l’élection d’Emmanuel Macron est emblématique de cette tendance et préfigure ce que sera la politique dans toutes les nations occidentales. Mais voyons de plus près ce que sont la gauche et la droite, ainsi que ce qui laisse penser qu’elles seront bientôt obsolètes.
La gauche
La gauche rassemble la classe instruite et urbaine, relativement jeune et qualifiée, ainsi que le personnel d’encadrement protégé par un statut de fonctionnaire. Rien qui ne puisse la tenir longtemps à l’écart du déclassement, au contraire. C’est donc là que s’origine une forme de revendication politique conforme au cours actuel : le démocratisme radical, que l’on a reconnu chez Nuit debout ou Occupy[28]. Au mondialisme de la finance, des lobbies et des multinationales, il oppose le bon mondialisme des organismes supranationaux et des organisations non profit ; c’est un débat policé entre des personnes qui ont fréquenté les mêmes universités, siègent dans les mêmes parlements et publient des tribunes dans les mêmes journaux. Ces discours sont beaucoup moins clivants que le conservatisme dont nous parlerons plus loin car ils défendent une vision unanimiste de la société — les 99 % — contre une toute petite minorité d’accapareurs[29]. On exige dans d’interminables assemblées une humanisation de l’économie, en prenant au mot l’idéologie démocratique comme si l’exploitation n’existait pas, sans oublier la défense du service public et l’appel à des mesures de régulation.
Mais cette lutte contre le 1 % super-riche ne vise en définitive qu’à garantir un salaire décent — la décence étant définie comme la limite à la dévalorisation du diplôme. C’est le problème des salariés autrefois choyés car instruits, et qui aujourd’hui sont démonétisés à mesure de la massification de l’enseignement supérieur, des progrès de l’intelligence artificielle et de la capacité grandissante des formations sociales périphériques à produire du personnel qualifié et volontaire pour l’émigration. La déflation des coûts du savoir et de la force de travail de ses propriétaires advient toutefois assez lentement pour que ce morne déclin puisse se vivre avec une certaine retenue, dans des formes admises par la démocratie, par exemple en votant contre le fascisme quand le candidat de la gauche est absent du second tour.
N’importe quel formalisme démocratique est bon à prendre, du moment qu’il se joue dans l’entre-soi, avec l’État comme communauté des citoyens. Les inégalités dont il est question ici — par exemple dans les choix d’orientation professionnelle de la seule jeunesse middle-class, ou de dotations territoriales — cachent les inégalités entre les groupes sociaux : on invente de nouveaux sujets et des problèmes inédits quand on ne sait plus voir le malheur prolétarien, parce qu’on ne veut plus le voir. L’objectivité de l’exploitation du travail dans le rapport social minéralisé en économie s’efface ainsi devant une pléthore de postures et de modes de vie exemplaires. Cela finit toujours par engendrer un malaise vis-à-vis des pauvres qui s’achètent des écrans plats plutôt que des carottes bio. Il en découle immanquablement la conviction d’une supériorité éthique et la multiplication des stratégies d’évitement social et géographique, qui bien sûr ne s’avouent jamais comme telles. Un exemple classique de cette hypocrisie est donné par les enseignants, journalistes ou politiciens qui vantent publiquement l’ouverture à la diversité — c’est-à-dire, dans le cas français, la cohabitation avec des populations d’origine maghrébine et subsaharienne — et dont les enfants sont habituellement scolarisés dans les écoles les plus homogènes grâce au contournement de la carte scolaire.
Le middle-class de gauche occupe la scène des luttes et produit, en spécialisant celles-ci par leur découpage en autant de champs académiques et militants, le discours autorisé sur la société, qui reflète tout en la neutralisant la segmentation du prolétariat dans sa reproduction différenciée, ainsi que la dépolitisation de celui-ci. Ce discours appelle une approche gestionnaire d’autant de questions de minorités qui font à leur tour l’objet d’une saisie démocratique et partant, l’affaire de l’État et le profit de l’industrie culturelle.
Ailleurs, un autre secteur très minoritaire de la classe moyenne anticipe son déclassement — qui est assurément la fin d’un monde, le sien — en bricolant sans plus attendre son petit radeau de la méduse, loin des pollutions du monde extérieur. Cette recherche de la micro-auto-suffisance exprime l’inquiétude de la petite-bourgeoisie culturelle la plus lucide : elle ne sera jamais plus aussi heureuse qu’aujourd’hui — et encore, ce n’est rien par rapport au bonheur qu’ont connu ses parents. Il lui faut donc postuler, pour se donner une chance de croire que sa situation enviable puisse survivre aux évolutions dangereuses du capitalisme, qu’elle ne dépend pas d’une chose aussi vulgairement matérielle que le rapport entre un propriétaire et un sans-réserves, mais plutôt d’une posture que l’on adopte face au monde, un ensemble de comportements à partager avec des amis sélectionnés par et pour la reproduction sociale. Ce qu’une assise socio-économique relativement confortable permet de manquer, c’est donc l’objectivité de la crise du capitalisme comme désintégration sociale, d’où découle la croyance en un salut qui réside dans les solutions pratiques. Cela tourne au spectacle de l’alternative, qui se signale habituellement par une très forte homogénéité sociale des communiants — expression de leur incapacité à inclure ceux qui sont bien plus durement traités par le mode de production et qui n’ont par conséquent pas les moyens de payer le ticket d’entrée.
L’impossibilité, dans le cadre de la restructuration, de sauvegarder indéfiniment des niches protégées de revenu, et d’assurer le classement des fractions instruites du salariat, détermine, finalement, la possible exclusion de la gauche du champ politique.
Droite et extrême-droite
La droite de gouvernement exprime les intérêts d’une partie de la grande bourgeoisie ainsi que des classes moyennes supérieures. Schématiquement, elle regroupe un segment de celles-ci, notamment la fraction entrepreneuriale qui a bien géré la dérégulation et la libéralisation des marchés, les petits et tout petits capitalistes, partie des professions libérales et surtout les retraités qui assurent sa survie électorale — en France, 74 % d’entre eux ont voté pour Macron au second tour[30], tandis qu’au premier tour, 40 % des plus de 65 ans ont voté pour le candidat de la droite François Fillon[31]. On peut d’ailleurs considérer que de par leur nombre dans les démocraties vieillissantes, les retraités forment, avec l’abstention très haute chez les ouvriers et les employés, le véritable rempart contre le populisme politicien. Certaines fractions de la grande bourgeoisie peuvent avoir, localement, un intérêt pour le protectionnisme. Sans cela, c’est surtout l’anti-fiscalisme, donc la défiance envers l’État dépensier et interventionniste, qui peut rapprocher la droite de certaines variantes du populisme.
Mais dans le moment actuel, c’est indéniablement l’extrême-droite qui retire le plus grand bénéfice de la tendance. Son positionnement est structurellement renforcé par l’effacement du mouvement ouvrier, car elle se définit notamment par le refus des luttes sociales au nom d’une conception organique de la société. Elle peut prononcer sa condamnation de l’époque sans plus recevoir le démenti des luttes porteuses d’une morale antagoniste, celle du travail et des travailleurs associés contre la rapacité des patrons. Cependant la scission entre la gauche et son électorat traditionnel n’est pas passée inaperçue, et à présent nous la voyons, petit à petit, revenir sur un terrain social qui lui a été longtemps interdit, et qu’elle a longtemps dédaigné en retour en affectant une pose aristocratique. Mais s’il n’y a plus de contradiction vivante qui embarque la société dans toutes sortes de mésaventures, il ne reste alors que de mauvaises idées qu’il faut remettre à l’endroit. Ce qui l’amène à redécouvrir chaque matin l’importance du combat culturel, qui signifie en substance faire de la réclame pour la restauration de telle ou telle organisation sociale, selon que l’on place le curseur de la décadence en 68, en 45, en 1789, ou bien avant encore.
À rebours du discours qui tient encore lieu d’idéologie dominante — la culture et l’université sont les derniers bastions de la gauche —, le conservateur voit dans la possibilité d’un choix dans le mode de vie, ou dans la capacité d’opérer des hybridations et en somme de contrôler ce qui informe notre identité personnelle et sociale, le signe distinctif des privilégiés qui ont les moyens de s’adapter, c’est-à-dire de collaborer activement à l’enlaidissement du monde. La contrainte sociale représente a contrario le gage d’une loyauté envers tous ceux — « le peuple » — qui n’ont jamais pu décider de rien, et qui de fait deviennent les dépositaires d’un héritage menacé de souillure. La tradition du collectif croit enfin tenir sa revanche sur l’universalisme de l’individu isolé[32], aspirant au blocage de toute circulation des choses et de la force de travail qu’elle ne pourrait contrôler dans la forme d’une politique de redistribution des richesses, et qui nourrit une nostalgie brouillonne pour tout ce qui a été connu autrefois comme se tenant hors de portée de la prostitution généralisée du négoce. Contre le sujet du capitalisme pour qui tout peut se substituer à tout, contre le nihilisme intrinsèque de la commensurabilité universelle, le conservatisme énumère rageusement tout ce qui doit faire exception selon lui aux lois qui gouvernent la marchandise.
Ne voulant toutefois rien connaître de l’opposition entre les classes du capital, il échoue à structurer sa haine des producteurs d’idéologie progressiste — journalistes, artistes, publicitaires, chercheurs et universitaires, gens du spectacle, etc. — autrement que dans la forme du complot, en caractérisant ceux-ci comme appartenant à une clique au service d’une vision du monde anti-nationale mondialiste et hostile aux institutions naturelles comme la famille. Son avantage sur le populisme entrepris par la gauche — comme chez Wagenknecht en Allemagne, Mélenchon en France et Corbyn en Angleterre — réside en ceci qu’il n’a pas à s’embarrasser de l’État comme communauté de tous les citoyens. Cela permet à l’extrême-droite de s’en prendre à des segments du prolétariat d’immigration ancienne ou récente, qu’elle n’a d’ailleurs pas elle-même caractérisés comme tels. Elle vise également la finance et le mauvais capitalisme, en les personnifiant en marionnettistes, corps étrangers et parasitaires qui vampirisent la richesse nationale. C’est aussi pour elle l’occasion d’attaquer experts et technocrates, et d’affirmer contre eux les prérogatives du politique.
Le rapport à l’État est ici fondamentalement ambivalent. D’une part, il est regardé comme le premier rempart face à l’économie mondialisée, et donc comme le meilleur garant de la protection des travailleurs nationaux contre les effets délétères du libre mouvement des marchandises et de la force de travail. La politique de Trump l’illustre de façon exemplaire, avec la taxation sur les importations des formations capitalistes concurrentes et la construction du mur à la frontière mexicaine. Mais d’autre part, il apparaît aussi aux yeux des nationalistes occidentaux comme un édifice infiltré par des forces inféodées aux instances supranationales. Cet état de fait réclame évidemment des coupables, que sont les partis gagnés à l’idéologie libérale, le patronat, les francs-maçons, les lobbies, les multinationales et bien sûr les juifs.
Conspirationnisme et antisémitisme
Il existe une nébuleuse de groupes et groupuscules parmi lesquels la théorie conspirationniste est réactivée en proposant une lecture de la crise actuelle, distribuant les rôles de victimes et coupables. C’est un système de certitudes dont la fixité rassure. Il faut reconnaître que l’époque lui est favorable : l’immense accumulation de marchandises forme le spectacle d’un monde où la raison s’est perdue, où la production n’est plus qu’un moyen qui a pour but l’expansion permanente de la survaleur[33]. Ce procès d’accumulation obéit à une logique structurelle, identifiée depuis longtemps au cours normal de l’évolution, et c’est pourquoi il échappe à une compréhension facile et immédiate. C’est ici, dans cette difficulté précisément, que s’origine la force du conspirationnisme, bien plus encore que dans les carences de l’information produite dans le cadre de la concentration monopolistique des médias de masse. Ignorant l’historicité du capitalisme, en toute chose le complotiste ne voit que volonté et stratégie, les manipulateurs et les idiots utiles, ce qui a pour effet d’éviter tout questionnement sur l’économie et ses catégories. Il y a désignation d’une subjectivité à la manœuvre, qui se cache derrière les mouvements en apparence désordonnés des marchés. Une subjectivité qui, une fois qu’elle a été repérée, peut et doit être combattue. C’est ce qui attire le conspirationnisme dans l’orbite du populisme : le dévoilement de la domination au sein des sociétés occidentales, à partir duquel se donne la possibilité de plier celles-ci à un autre devenir, en rupture avec le présent. Cette vision s’oppose de fait au réalisme anti-utopique de la transparence des marchés et se tient souvent au principe de la politisation chez les plus jeunes.
L’antisémitisme compte parmi les composants les mieux structurés du fond conspirationniste. Les juifs seraient l’incarnation symbolique du mauvais capitalisme, ses représentants : nomades, apatrides, rapaces, il y a chez eux un irréparable manque de loyauté envers la nation où ils prospèrent grâce à la ruse et au soutien tribal qu’ils trouvent dans leur communauté. Tout à leur amour du lucre, ils ont historiquement dédaigné les travaux pratiques — seule origine en définitive des richesses réelles — et sont passés maîtres dans l’économie parasitaire et spéculative, comme dans l’art du verbe, de la tromperie et du mensonge. Ils soutiennent le projet sioniste, notoirement nationaliste et identitaire, mais condamnent en revanche tout projet similaire entrepris par les Européens. Pour les fractions les plus dures de la droite extrême, cette duplicité ne révèle pas du seul égoïsme national, mais une volonté d’affaiblissement des nations blanches, qui passe par la promotion du Grand Remplacement sous les airs d’un éloge de la société multiculturelle et de l’enrichissement que représenterait l’immigration pour les pays d’accueil, ainsi que par la déconstruction de tout ce qui fait l’identité de ceux-ci. Cette œuvre de longue haleine, dictée par la haine atavique et le ressentiment propres à la race juive, et par la conviction que le meilleur moyen d’assurer la domination de son propre groupe est d’organiser le métissage et l’amnésie culturelle des autres nations, constitue le complot par excellence, apte à contenir tous les autres. Il n’est évidemment pas possible, aux yeux des nationalistes, de déjouer une menace de cette nature par le truchement du mécanisme démocratique, avec les innombrables prises qu’il offre à la corruption par les puissances d’argent, ses rythmes délibératifs, ses chicaneries partisanes et ses méandres constitutionnels. L’heure est au retour du politique en grand format : la maîtrise des destinées du peuple appelle ses grands hommes et ses décisions irrévocables.

Retour au prolétariat
Il n’y a pas dans le prolétariat de glissement univoque et sans retour vers les nouvelles appartenances qui supplantent l’ancien monde ouvrier, ni de tension à la communauté qui ne soit toujours traversée par des contradictions qui en relativisent la puissance.
L’ancien monde est lent à mourir et la respectabilité personnelle sera encore longtemps fondée sur le travail. La stigmatisation des surnuméraires appelle logiquement la réappropriation du stigmate, et ce dans toutes les fractions du prolétariat, selon des modulations qui obéissent à l’histoire locale de la force de travail. Cette subjectivation est presque toujours toxique et explique qu’ils soient devenus, aux yeux de ceux qui ont des raisons de croire qu’ils conserveront encore longtemps leur emploi, de ceux qui n’ont jamais eu besoin de travailler et de ceux qui dans leur vieillesse amère trouvent que les jeunes ne travailleront jamais assez, une populace. Et l’actualité récente a prouvé à leurs yeux qu’elle est désormais capable de se regrouper en foule haineuse, c’est-à-dire en un groupement d’hommes et de femmes qui ont réussi quelques instants à déroger au commandement libéral du « chacun pour soi et tous contre tous », pour se liguer contre le pouvoir, ses représentants, ses quartiers et sa police.
Mais cette représentation de soi que donne la plèbe, qui est d’autant plus remarquable qu’elle ne passe pas par la médiation de la classe qui maîtrise le discours, ne dit pas toute sa vérité ; et l’histoire enseigne l’extrême labilité des constructions identitaires : si le vecteur inclusif des luttes sociales a faibli avec la fin des revendications salariales, il est vrai qu’une résurgence de la conflictualité de classe ne manquerait pas, une nouvelle fois, de briser ou du moins d’affaiblir les segmentations. C’est d’ailleurs l’espoir syndical et gauchiste ancienne manière, celui qui est porté également par les populistes de gauche, mais c’est un espoir qui s’estompe inexorablement à mesure que l’évidence de la superfluité d’un volume colossal de force de travail s’impose, en dépit de tous les trucages statistiques qui voudraient faire croire le contraire. D’autre part, il n’y a pas de classe qui puisse être rendue à sa pureté, et il n’y a pas non plus de racines authentiques à reconquérir. La lutte désordonnée entre les identités se déroule ainsi dans le cadre historique qu’elle trouve, mobilisant les sédiments des flux de travail vivant qui se sont succédés, ce qui inclut d’abord les composantes religieuses et culturelles. Ces strates se lisent dans la physionomie, l’évolution de la langue argotique ou encore la manière d’habiter l’espace urbain. La crise de la société de classe met en branle tout cela, dans une énorme contrebande de marchandises culturelles où toute une camelote moderniste s’écoule comme le nec plus ultra de la conformité au roman national, de la fidélité aux textes sacrés ou encore de la loyauté aux ancêtres.
Les immigrés
Le rejet en marge de la vie convenablement salariée, s’il intéresse des masses toujours plus nombreuses et indisciplinées, loin de procéder de façon aléatoire, intéresse d’abord les derniers arrivages de la force de travail. Ceux-ci proviennent des gisements de main-d’œuvre plus lointains et sont comme tels plus facilement identifiables, aussi la race retrouve-t-elle du service comme marqueur d’inutilité sociale et partant, délimite les espaces de plus intense recomposition des solidarités exclusives.
Cela advient d’autant plus facilement que l’expansion du capital, par la soumission de toutes les formations sociales qu’il rencontre – avec la force pour capturer leurs ressources et rendre du même coup impossible leur reproduction sur leur ancienne base ; au niveau symbolique en détruisant leur horizon de sens pour imposer l’accumulation infinie comme finalité absolue et comme domination locale d’une classe sur les autres –, constitue en même temps et nécessairement celles-ci comme attardées et inférieures. La contingence d’un tel évènement, qui a pris historiquement la forme du colonialisme et de l’impérialisme, est niée dans la naturalisation des catégories produites : l’infériorité de l’autre se justifie maintenant d’un fait de nature, c’est-à-dire par la race, ou par euphémisme la culture. L’altérité se transforme dans tous les cas en une aberration locale sommée de s’effacer devant l’universel, que le bourgeois fait ruisseler depuis les sommets de la civilisation.
Mais chez les prolétaires de la métropole, fussent-ils immigrés, de longue date ou non, la machine à civiliser a connu ses beaux jours, la crise de la reproduction devenant de façon manifeste la crise du bourgeois civilisateur et de son idéologie universaliste. Si du point de vue de la théorie, l’impossibilité de reproduire l’ensemble de la force de travail indique le remplacement nécessaire du bourgeois (ou plutôt, le rapport social dont il est la figure) par autre chose et si possible par l’immédiateté sociale des individus, dans le moment présent c’est encore à sa dimension idéologique que l’on s’attache : cette société est déclarée perdue par cela même où elle a si longtemps dominé, c’est-à-dire par la puissance développée sous le capital qui s’est retournée en une puissance de déliaison et d’anomie. Les promesses de l’émigration ont abouti à l’impasse, sauf que cette fois il n’est plus possible de retourner au pays, ni de rembobiner le film jusqu’au stade de développement où l’essor du petit commerce et de l’artisanat posait au moins en apparence les conditions d’une vie décente.
Dans les strates déshéritées de l’ancien mouvement ouvrier, pour le travailleur immigré qui était par la grâce du travail avant tout un travailleur et, accessoirement, un immigré, il n’y a alors plus d’avenir ni espoir conforme à un modèle d’intégration classique, c’est-à-dire par le travail. Il reste l’héritage culturel, la mémoire, la narration plus ou moins fantasmatique qui à défaut d’aider à la survie, soigne quelque blessure narcissique. Tout ce qui se manifeste ailleurs que dans le périmètre de familiarité, en revanche, que ce soit dans la politique des grands fonctionnaires ou dans la matérialité de la ville mondialisée, dans les modes de vie éthiques de la classe moyenne ou le luxe insensé des plus riches, incite à la défiance. C’est un populisme des minoritaires qui, à la différence du courant principal, ne peut pas refonder l’État sous le contrôle des fractions souverainistes des petite et grande bourgeoisies. C’est aussi pourquoi il n’a d’autres choix que de nouer des alliances avec les entreprises populistes nationales (possibilité de l’antisémitisme comme œcuménisme populiste), ou de s’attacher à des puissances étrangères (irrédentisme, islamisme). Il se dresse dans ce cas face aux autres populismes et ensemble ils construisent le conflit comme une reproduction miniature du choc des civilisations.
Au sein du prolétariat autochtone, la suspicion vis-à-vis des immigrés se nourrit de l’idée que ceux-ci, étant si mal lotis sous le rapport de leur employabilité, vont nécessairement accepter n’importe quel expédient pour survivre. Cela signifie en premier lieu le détournement des systèmes d’assurance contre la maladie et la perte d’emploi afin de s’établir dans une inactivité prolongée, éventuellement combinée avec des périodes de travail non déclaré. Mais cela signifie aussi, pour ceux qui entrent sur le marché du travail, exercer une concurrence déloyale aux dépens de leurs concurrents directs, c’est-à-dire les ouvriers plutôt que les ingénieurs. Une telle situation jure évidemment avec certaine conception de la moralité du travail, fidèle à l’image du travailleur comme étant plus apte que la bourgeoisie à diriger la formidable puissance productive posée par le développement aliéné, mais aussi comme dépositaire d’une éthique supérieure où l’égoïsme ferait place au souci du bien commun.
La méritocratie ouvrière constitue aussi un puissant facteur de division au sein du prolétariat, car elle installe un clivage gagnant/perdant qui escamote le destin collectif de la classe. Cette vision enchantée du travail et de sa valeur admet de plus difficilement l’existence d’une main-d’œuvre superflue, car cela reviendrait à reconnaître la démonétisation de la force de travail dans son ensemble et amènerait in fine à penser le travail et sa célébration dans une perspective historique. On court alors le risque (ou la chance, selon le point de vue) de lui préférer, tout bien pesé, l’oisiveté. En attendant, l’heure est plutôt à la recherche d’un vice caché dans chaque force de travail touchée par le désœuvrement : le statut de chômeur se transforme alors en attestation d’immoralité, qui réactive et confirme les préjugés racistes formés dans une phase antérieure.
Et pour ne rien arranger, chaque prolétaire, national ou descendant d’immigrés, devine désormais dans le clandestin son propre devenir : un être seul et impuissant, absolument dépendant de la même société qui l’a si peu considéré. L’existence d’un marché aux esclaves en Libye, la chosification de l’homme et sa mise à prix, et ici la nécessité de plus en plus fréquente de cumuler plusieurs emplois pour s’en sortir, cela dessine peu à peu les contours d’une condition commune, et totalement invivable. Les populistes ont beau jeu d’exploiter cette crainte, en présentant les partisans de l’intégration européenne comme étant hostiles aux valeurs traditionnelles, lesquelles n’auraient pas autorisé une telle dérogation au privilège d’être né dans une économie avancée. C’est en fait la négation de ces valeurs qui permettrait aux « mondialistes » de vanter le caractère positif, et de toute façon inévitable, des futures migrations de masse.
Cela amène inévitablement, dans l’esprit de ceux pour qui ces valeurs évoquent la perte d’un monde, un constat sur l’immigration : le mouvement des plus pauvres se confond avec le mouvement de la pauvreté elle-même. Il est l’étalement planétaire de l’esclavage au bénéfice d’une élite hors-sol. Une élite qui s’oppose à la construction de murs le long des frontières nationales et en même temps érige des murs autour des quartiers chics où elle a élu résidence. Il importe donc de mettre la plus grande distance possible entre ici et là-bas. La frontière peut alors s’offrir comme le moyen de déjouer l’obsolescence de la force de travail, tandis qu’en toile de fond, la poussée démographique, couplée au réchauffement climatique, font craindre l’annulation de toutes les distances et l’alignement des conditions de vie de tous les surnuméraires au niveau des plus miséreux. Il y a tout lieu de penser que les grandes heures de l’enracinement, entendu ici comme politisation du lien entre les habitants et leur lieu de vie, sont devant nous, et que cette nouvelle politique du territoire sera systématiquement poussée à ses extrémités par les groupuscules radicaux qui aspirent au rétablissement des communautés mythiques des fascismes historiques.

Un désastre
Aujourd’hui
La réactivation des catégories de territoire, de nation, de race, ainsi que l’évolution vers un monde multipolaire où la conflagration entre les formations capitalistes principales a déjà commencé — tout cela montre que l’instabilité sociale augmente. L’économie et ses propriétaires semblaient à l’abri du temps, les voilà repris par la fin de la fin de l’histoire. La confluence de la catastrophe écologique, des crises annoncées des dettes souveraines et des mouvements migratoires — les trois font système — détermine un cadre où l’on ne voit pas ce qui pourrait empêcher la tendance populiste de se constituer en nouveau paradigme. À un niveau purement politique, les bourgeoisies nationales ne méconnaissent pas la séduction qu’opèrent le nationalisme et le conservatisme, et il est clair dès à présent qu’il n’est pas d’accommodement qui ne puisse se trouver pour y amener les segments électoraux jusqu’ici réfractaires. Que cela ne masque pas l’essentiel : ces politiques identitaires, axées sur une conception exclusive de la solidarité, ne seraient rien si elles ne rencontraient, dans l’échec de l’économie à socialiser de vastes segments de la population sous le capital, la raison fondamentale de leur actualité.
Cette crise de la reproduction sociale, qui est à la fois cause et conséquence de son découplage avec la valorisation, est aussi la crise définitive d’un procès révolutionnaire dont le contenu serait identique à celui du programme du mouvement ouvrier. Le populisme joue ici à la fois comme un révélateur de crise et comme son dépassement impossible. Révélateur car, comme tension vers la communauté, il est le produit d’une socialisation incapable de mobiliser toute la force de travail et de se l’attacher comme autant d’individus échangistes et maximisateurs de leurs intérêts ; dépassement impossible parce que, toujours saisi dans les filets des bourgeoisies dominantes — du moins aussi longtemps que cette domination sera assurée — le populisme politicien ne construit pas un antagoniste du capital, mais dispose plutôt une réforme plus ou moins radicale de celui-ci.
Cependant le nouveau cours politique — protectionnisme, dévaluation, militarisme, expulsion de masse, élimination des surnuméraires, pillage et prédation d’autres nations — ne répond pas à son problème réel, et ce n’est pas une question de bonne volonté. L’avènement du peuple n’admet en effet aucune formule politique, puisque la politique elle-même présuppose une société, le fameux lien social. Si ce dernier a joui de quelques apparences de bonne santé à l’époque de l’intégration consumériste, il en va tout autrement aujourd’hui. Le lien social meurt, dans l’exacte mesure où la société se rétrécit au périmètre de mobilisation par et pour le travail. C’est la fin honteuse d’une sociabilité dont on n’a jamais autant parlé depuis que l’impossibilité de se faire respecter sans chercher à écraser ses semblables est devenue manifeste pour tout le monde[34].
Demain
L’État entraîné dans la crise ne pouvant plus se maintenir dans sa forme institutionnelle — ses prérogatives apparaissant de plus en plus injustifiées en regard de ses agissements sectaires qui ne profitent qu’à une part décroissante de sa population, pendant que la paix civile nécessaire aux affaires se trouve ruinée — il se déchire entre diverses fractions oligarchiques. Dans le même temps, les conflits entre les blocs nationaux se gangrènent et dégénèrent en interminables guerres de bandes, avec des segments d’États faillis qui s’affrontent pour le contrôle de ressources en déclin. À ce stade, il devient impossible d’assurer le fonctionnement de la totalité de l’appareil productif posé par le capital. Enfin, les aires où la dépendance à l’organisation techno-scientifique actuelle est trop forte sont abandonnées, provoquant des mouvements de population massifs qui à leur tour peuvent devenir des facteurs de déstabilisation. Finalement, même les moyens élémentaires de survie ne sont plus assurés.
Ce scénario comprend la chute des structures portantes du pouvoir de la classe possédante dans un moment plus large de régression générale des savoirs, des techniques et de la pensée. L’économie de rapine, de pillage et de survie appelle et renforce ultérieurement des liens personnels de dépendance qui sont déjà en phase de consolidation. La dureté d’une telle existence pourrait doter les clans, les bandes et les hordes d’une conscience très vive des loyautés qui assurent leur pérennité. L’individu s’efface au profit du groupe, la violence est déployée vers l’extérieur et c’est par elle que l’on cherchera à régler le problème de la survie matérielle, en soumettant les bandes rivales et en prenant sur le tas chez les autres. Cette stratification sociale émergente libère du même coup les instances de pouvoir et les membres de la communauté du fardeau de la production des moyens de subsistance. L’économie n’organise plus la vie des maîtres, et le travail, à nouveau constitué en objet du mépris, échoit désormais exclusivement aux esclaves. Il y aurait donc un avènement d’une communauté post-capitaliste au milieu de ce désastre de la vieille société, mais dans la forme, vraisemblablement, d’une nouvelle féodalité.
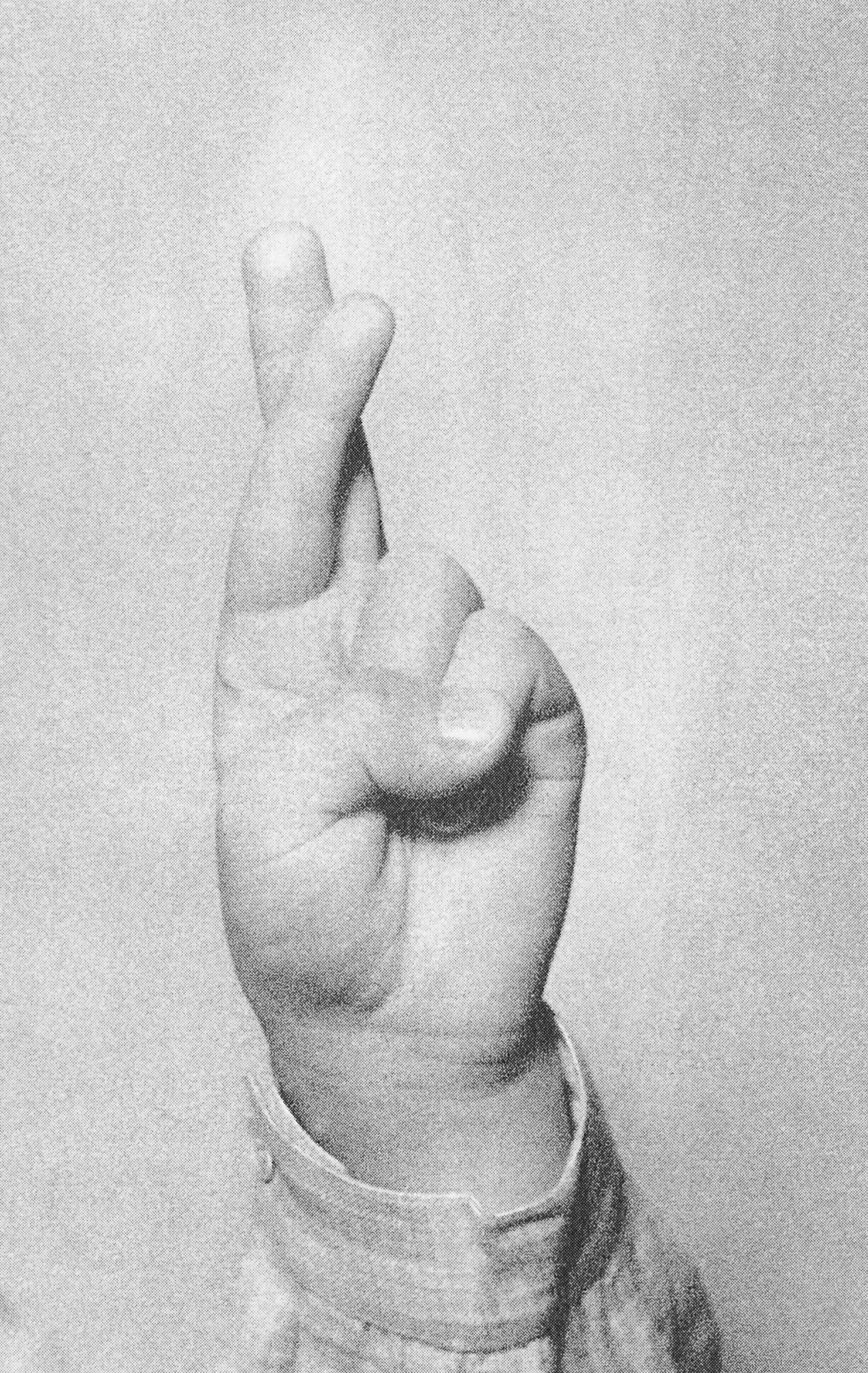
Communisme ?
Dans la mesure où nul ne saurait identifier les signes annonciateurs d’une révolution communiste — à supposer qu’une telle révolution constitue, ou a pu constituer, un devenir possible du capitalisme —, nul ne sait non plus si le cours actuel nous en rapproche ou non. On peut cependant se demander ce qu’il se passerait en cas d’accident industriel dans la reproduction des strates instruites de la classe moyenne, par exemple à la suite d’une guerre nucléaire ou d’une catastrophe écologique d’une gravité extrême, une gravité de l’ordre de l’impensé. Mille fois Fukushima. Une grande peste. Un cataclysme écologique. Un événement qui de par sa soudaineté déjouerait les lois du séparatisme social par lequel se compartimente si bien le malheur, en obligeant à affronter immédiatement la question de la survie de tous.
Est-ce que cela provoquerait un déraillement du populisme, une implosion de ses aspects identitaires exclusifs ? C’est peut-être à cette condition que les pratiques alternatives des adultes sympas, telles que les jardins partagés, les cuisines communautaires, les squats, deviendraient des mesures qui socialisent réellement — c’est-à-dire au-delà de la petite différence narcissique. Une modalité inattendue d’encanaillement à grande échelle des paroissiens du mode de vie éthique, la multiplication des mauvaises fréquentations : voilà un point de départ pour l’organisation de l’existence des surnuméraires aux dépens de la société et de son État. Cela tout en déjouant les tendances à circonscrire la solidarité à ce qui est immédiatement connu — et qui se confond souvent avec ce que l’on connaît déjà, contre tout le reste que l’on déteste déjà. Tenant compte qu’il n’y a pas de place sur terre pour deux organisations sociales différentes quand la loi de l’accumulation infinie loge au cœur de l’une d’elles, cette lutte ouverte serait une lutte à mort.
Et une utopie. Seule communauté qui n’en serait pas réduite à gérer le désastre de l’économie et tenter d’y survivre en roulant dans l’ornière d’un néo-féodalisme, née des noces traumatiques des cyclistes diplômés et des beaufs motorisés, de la prolétarisation forcée de presque tous et de la chute concomitante dans le cloaque identitaire, elle saurait reconnaître ses penchants essentialistes pour ce qu’ils sont, à savoir comme les produits du crépuscule de l’économique pour des masses immenses de surnuméraires. Ayant atteint une conscience juste du fonctionnement de la société, la populace, ou le peuple, selon le point de vue que l’on adopte, reconnaîtrait à ce stade son problème comme étant celui du communisme.
Mais alors, ce problème serait également celui de l’universalisme abstrait et de l’individu propriétaire : l’impossibilité de s’affirmer comme une classe face à une autre classe entraînant la nécessité de s’affirmer autrement, de tendre à une autre socialisation, et en définitive à affirmer le besoin pratique d’appartenance des humains comme moyen de liaison du passé et de l’avenir, donc comme lieu de transmission, de continuité et de sens, comme horizon de pensée nécessaire pour la réalisation des mesures communistes. L’homme s’est en effet toujours connu d’abord comme membre d’un groupe, élément d’un conglomérat humain déterminé et délimité (Marx) ; il n’est devenu pensable comme individu que dans la forme modernisée de l’esclavage. Sous ce rapport, c’est bien le moment de socialisation sous le capital — y compris dans sa déclinaison bureaucratique — qui constituait un intermède singulier puisqu’il produisait en même temps l’interdépendance et l’atomisation. Au contraire, dans l’hypothèse communiste, l’identité qu’ont en partage les surnuméraires n’est pas au principe de la communauté — ce serait une identité carcérale, quand bien même elle serait minoritaire et dominée —, mais au terme de la négation de leur condition de surnuméraire. Et c’est pourquoi personne ne peut dire ce qu’elle sera.
Dans tous les cas : la communauté qui tend vers l’universel concret, et qui écarte ce faisant l’autre terme de l’alternative — soit la guerre généralisée entre bandes et les micro-patriotismes bellicistes qui se disputent les débris de la communauté matérielle — comprend virtuellement l’espèce humaine. La guerre contre les néo-féodaux, qui ne voudront pas se dissoudre et la rallier, la sépare de l’ancien monde et de ses survivants non plus sur la seule question de l’appartenance, mais par la lutte incessante contre la division du travail, et l’affirmation de la nature égalitaire des liens personnels et qualitativement particuliers qui auront à ce stade supplanté l’échange. Cette communauté est en fait la médiation entre la singularité irréductible de chaque vivant et l’universel. Elle est ce paradoxe par lequel l’incommensurable fait retour sous le signe de l’égalité. Elle est l’une des fins possibles du nihilisme, la seule peut-être qui n’entraîne pas le rejouement des vieilles formes de domination.
[1] Pascal Perrineau, Le Vote disruptif, Presses de Sciences Po, 2017, p. 259 et suiv.
[2] Annex Muxel, « L’entrée des primo-votants dans l’arène électorale de la présidentielle », La Note, n°19 (Cevipof), mai 2016.
[3] Ipsos, « Européennes 2019 : Sociologie des électorats », cf. site.
[4] « Les élections régionales en Saxe », cf. Wikipedia.
[5] Guy Chazan, « Most refugees to be jobless for years, German minister warns », The Financial Times, juin 2017.
[6] Grégoire Normand, « Le bilan en demi-teinte de Merkel en cinq graphiques », La Tribune, septembre 2017.
[8] Krishnadev Calamur, « Why Sweden’s Far Right Is on the Rise », The Atlantic, septembre 2018.
[9] Gaël Branchereau, « Has support for the Sweden Democrats peaked? », The Local, septembre 2018.
[10] Serge Halimi et Pierre Rimbert, « Libéraux contre populistes, un clivage trompeur », Le Monde diplomatique, septembre 2018, p. 22-23.
[11] Jean-Philippe Buchs, « Les entreprises creusent les inégalités de revenus », Bilan, mai 2018.
[12] « Un patron gagne 347 fois plus qu’un salarié, aux États-Unis », Capital.fr, mai 2017.
[13] Voir le Global Wealth Report publié par le Credit Suisse, mai 2017.
[14] Steve Tenre, « Overdoses, suicides, obésité... Aux États-Unis, l’espérance de vie est en berne », Le Figaro, octobre 2019.
[15] La percée de l’Ukip va d’ailleurs entraîner l’effondrement du parti d’extrême-droite British national party.
[16] Ipsos, Elezioni politiche 2018, analisi post-voto.
[17] Sondaggi BiDiMedia, Elezioni Politiche 2018: la sociologia del voto.
[18] « Sorpasso Lega nei sondaggi, si scalda il derby con il M5S », Il Quotidiano, septembre 2018.
[19] Voir par exemple le rapport en ligne d’Oxford Economics, How Robots Change the World, selon lequel dans les dix prochaines années, 20 millions d’emplois dans le secteur manufacturier seront automatisés. Pour l’Organisation de coopération et de développement économiques, 14 % des emplois devraient être entièrement automatisés d’ici à 2040.
[20]Pascale Poulet-Coulibando et Anne Testas, « Le niveau d’études de la population et des jeunes », cf. site du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
[21] Louis Maurin, « Comment expliquer l’hypocrisie de la gauche », Observatoire des inégalités.
[22] Céline Braconnier, Jean-Yves Dormagen, La Démocratie de l’abstention, Gallimard, 2007, p. 185.
[23] Insee, « Catégorie socio-professionnelle selon le sexe et l’âge en 2018 »,
[24] L’autogestion ouvrière conservait finalement le contenu fondamental de la production bourgeoise : la valeur.
[25] Voir Bruno Astarian et Robert Ferro, « Ménage à trois de la lutte des classes », Épisode 2, juin 2017. Alain Bihr ajoute que la classe dominante verse à la classe moyenne un sursalaire afin de l’intéresser à l’exercice de la domination du capital - raison fondamentale de son réformisme indécrottable.
[26] On ne parlera pas de dépassement ou de fin de l’économie avant que cette question de l’appartenance et de ses contenus concrets ne soit partagée massivement par ceux qui disposent des moyens de poser abstraitement des problèmes de ce genre. Autrement dit, quand le déclassement aura déclassé ceux qui ne sont aujourd’hui que virtuellement déclassés.
[27] Se référer au fameux rapport de l’association Terra Nova, qui recommande en 2012 au PS français d’orienter sa stratégie en direction de la « France de demain », définie comme étant une France plus jeune, plus féminine, plus diverse et plus diplômée. On peut y lire notamment : « Pour la première fois depuis plus de trente ans, un parti entre à nouveau en résonance avec toutes les valeurs des classes populaires : protectionnisme culturel, protectionnisme économique et social. Le FN se pose en parti des classes populaires, et il sera difficile à contrer. »
[28] La réforme de l’État prend une signification différente en fonction des contextes. Dans les cas de l’Egypte ou de la Tunisie, le poids de la classe moyenne est relativement faible, aussi les considérations qui suivent ne porteront pas sur ce que l’on a pu appeler le Mouvement des places.
[29] Il y a environ 36 millions de millionnaires – 0,5 % de la population mondiale – qui contrôlent 50 % de la richesse totale. C’était 42,5 % avant le début de la crise en 2008. Cf. Global Wealth Report du Credit Suisse, 2017.
[30] Sondage Ipsos, « 2nd tour présidentielle 2017 : sociologie des électorats et profil des abstentionnistes », mai 2017.
[31] Marie Bellan, Matthieu Quiret et Alexandre Rousset, « Présidentielle : Le vote du premier tour passé au crible », Les Échos, avril 2017.
[32] Voir TC n°26, mai 2018, p. 145.
[33] Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Mille et une nuits, 2009, p. 453.
[34] Le seul secteur qui ait encore un intérêt direct à voir adhérer aux sornettes du vivre-ensemble est celui-là même qui détient le monopole sur la production et la circulation de la marchandise culturelle qui en donne le spectacle mensonger : la bourgeoisie de gauche américaine à très fort capital économique et culturel, qui fait la navette entre l’Ivy league et l’industrie du divertissement de la Silicon Valley ; ainsi que ses homologues d’Europe occidentale, du haut fonctionaire du Ministère de la culture à l’étudiant radical-chic. C’est ce marécage incestueux du séminaire postmoderniste et de l’abêtissement du grand public que les conservateurs appellent le marxisme culturel. Nous espérons revenir sur ce thème dans le prochain numéro.