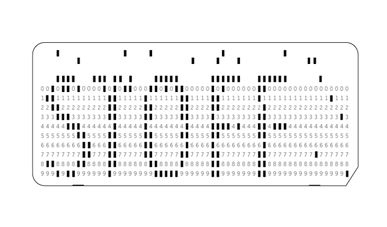Lorsqu’une vague de luttes a balayé le monde en 2019, d’abord au Soudan, puis à Haïti, Hong-Kong et au-delà, les États-Unis s’étaient glissés dans ce qui, même au regard de leurs propres critères, s’apparentait à une profonde léthargie. Le coup d’envoi de la campagne électorale contre le président Trump, campagne jusqu’alors indissociable de l’infatigable Bernie Sanders et de son socialisme libéral-démocrate, avait été donné dès que possible et cette fois-ci au moyen d’une machine idéologique et politique plus finement adaptée aux idées reçues de la gauche extra-parlementaire. L’anti-trumpisme s’était avéré un terreau fertile sur lequel cultiver l’engouement pour les réformes sociales-démocrates, en particulier quand celles-ci devaient s’incarner en la personne de l’irascible et truculent sénateur Sanders. Pour évoquer ce moment en termes crûment matérialistes, une participation accrue des électeurs anti-Trump aux scrutins locaux à la recherche d’une alternative au niveau local ou régional avait réveillé la possibilité pour les sociaux-démocrates de se retrouver aux manettes et de faire avancer leurs modestes projets de réformes, en particulier autour du salaire minimum. Ces victoires, quoiqu’insignifiantes sur le long terme, ont eu un effet revigorant pour un grand nombre de gens habitués à ne jamais rien gagner. Là où aucun espace de contestation politique ne se dessinait, des personnalités comme Alexandria Ocasio-Cortez, jeune députée fraichement élue dans le Bronx, sont néanmoins parvenues à susciter un idéalisme retors, faisant miroiter des possibilités censément réalisables dans un futur proche, et ce malgré le peu d’éléments concrets dont elles pouvaient se prévaloir, ou peut-être justement grâce à ça.
Jamais de toute ma vie une conjoncture politique ne s’était si rapidement et si résolument évaporée. Six mois plus tard, il n’en reste presque rien. Avec une épidémie de Covid-19 dont l’ampleur et la mauvaise gestion sidérante sont sans égal sur la planète, avec près d’un cinquième de la population active au chômage et quasiment aucune amélioration à l’horizon, avec 40 % des locataires menacés d’expulsion et un conspirationniste adepte du déni en guise de Président, les États-Unis se délitent à vitesse grand V. L’élection présidentielle de 2020, sujet numéro un des infos il y a six mois, semblait une préoccupation si lointaine pendant la plus grande partie de l’été qu’elle aurait tout aussi bien pu se dérouler sur Mars. En lieu et place de Bernie Sanders, dont la campagne a été balayée du jour au lendemain par un regroupement de forces du centre-gauche et le vote pavlovien des électeurs dévoués lors de la primaire, un scénario bien trop barbant pour qu’on prenne même la peine d’en parler, le parti démocrate a présenté son champion en la personne de Joseph Biden, ex-vice-président de Barack Obama, éternellement en lice, dont l’absence d’intérêt ou d’un quelconque contenu politique aurait dû, en d’autres circonstances, signer l’anéantissement de son parti décati. À l’heure actuelle, il est apparemment en passe de remporter l’élection, du simple fait de ne pas être Trump.
Autrement dit, à l’heure qu’il est, n’importe qui pourrait gagner face à Trump, n’importe qui perdrait en étant Trump. Biden est le « non-Trump », évidé de toute autre signification politique — la différence qu’il propose étant atténuée au point de disparaître. En réaction au soulèvement anti-police mené par les Noirs qui vient tout juste de balayer le pays, la plus intense, la plus large et la plus longue vague émeutière depuis les années 1960, il a proposé que les officiers de police soient formés à nouveau, afin de mutiler plutôt que de tuer, à tirer à hauteur de genou plutôt que dans la poitrine. « Flinguez-les tous » ou « flinguez-leur les genoux », voilà l’alternative. Quant à Sanders, lorsqu’on l’a interrogé sur les appels à couper en partie ou totalement les financements de la police, une revendication des émeutes de mai et de juin qui s’est faite plus pressante au cours de l’été, il a déclaré que la police avait besoin de plus de ressources et non de moins, un brusque revirement de la part de quelqu’un qui, quelques mois plus tôt, était qualifié de candidat du mouvement social. Nous savons à présent de quels mouvements et de qui il est le candidat.
Quand on écrira l’histoire de notre longue année 2020, le soulèvement en cours sera sans doute perçu comme un chapitre dans la construction d’un mouvement anti-police plus large, dont les principaux épisodes sont les émeutes Oscar Grant de 2009-2010 à Oakland, puis celles de Ferguson, Baltimore et d’autres villes en 2014 et 2015, qu’on désigne parfois sous l’intitulé Black Lives Matter (du nom d’un réseau d’organisations militantes qui s’est constitué à cette époque). Ce slogan sert encore aujourd’hui de mot d’ordre au mouvement, peint sur un millier de vitrines recouvertes de panneaux de bois et au milieu de la chaussée, mais ce postulat a évolué : le slogan « abolir la police » ou l’appel plus courant à couper les fonds de la police ont émergé et ils constituent la revendication autour de laquelle le mouvement s’oriente et se fédère, remplissant l’espace que de vagues appels à la justice auraient pu sinon occuper. Il existe une agressivité ou proactivité nouvelle dans la vague actuelle qui, comme l’a fait remarquer Joshua Clover, peut se déduire d’une simple observation. En 2014-2015, l’extension des émeutes à tout le pays, leur diffusion à d’autres villes au-delà des incidents déclencheurs — au Missouri, à New York et Baltimore — s’est toujours produite a posteriori, une fois que les tentatives d’obtenir justice ou réparation par des moyens judiciaires ont échoué. Cette fois-ci, personne n’a attendu un verdict. La vidéo qui a circulé, où l’on voit l’officier Derek Chauvin de la police de Minneapolis, qui est blanc, étouffant George Floyd, qui est noir, alors que ce dernier appelait à l’aide en suppliant, en hurlant « j’étouffe », formulait un verdict suffisant. Il faut noter que Floyd, âgé de 46 ans, avait été arrêté parce que le caissier d’une épicerie pensait qu’il lui avait fourgué un faux billet de 20 dollars. Dans son appel lancé le soir du 25 mai, le répartiteur de la police évoquait une « tentative de faux-monnayage », ce qui nous donne un aperçu du genre de lutte contre les atteintes aux biens que mène la police de Minneapolis au beau milieu d’une pandémie, à l’orée de la pire crise économique de toute ma vie. Il est remarquable que cela se soit produit alors que Trump et une majorité de gouverneurs, prêts à tout pour remettre les gens au travail, avaient poussé à alléger les mesures de distanciation sociale bien plus rapidement que ne le recommandaient les médecins, posant ouvertement une corrélation entre les cas de Covid-19 d’une part et la croissance économique de l’autre. Deux courbes — taux de mortalité, taux de croissance — et entre les deux une congruence brutale, une mesure brutale du prix de la vie.
Le jour suivant, le 26 mai, les gens se sont réunis devant le magasin Cup Foods où Floyd avait été tué et ont parcouru près de 4 km jusqu’au poste de police où travaillaient Chauvin et les autres officiers impliqués dans le meurtre, affrontant la police en chemin. Le 28 mai, ce commissariat sera entièrement parti en fumée, image d’une victoire qui a mis le mot « abolition » sur des dizaines de milliers de lèvres et lui a donné un sens concret. La police a quitté les lieux sur ordre du maire, espérant calmer les esprits. Les émeutiers les ont au contraire occupés, se sont emparés de tous les équipements utiles, puis y ont mis le feu et se sont rendus au commissariat voisin la nuit suivante. Des actions de solidarité ont eu lieu dès le 27 mai à Los Angeles, New York, Atlanta et Louisville, là où des manifestations contre des meurtres commis par des policiers s’étaient récemment retrouvées face à un pouvoir campant sur ses positions. Par exemple, les gens encore furieux du meurtre de Breonna Taylor, tuée sans sommation par un commando de policiers au cours d’un raid injustifié sur son appartement, peuvent aujourd’hui se joindre à cette vague nationale et, avec elle, trouver la force nécessaire pour abattre ces murailles aux couleurs de l’uniforme.
Quantitativement, cette force a vraiment de quoi impressionner. On n’a pas assisté à une vague d’émeutes de cette ampleur depuis l’assassinat de Martin Luther King en 1968. Plus d’une centaine de villes de différentes tailles ont été le théâtre d’émeutes entre la fin mai et le début juin : au 3 juin, au moins deux cents municipalités avaient instauré un couvre-feu, portant à cent millions le nombre de personnes susceptibles d’être arrêtées après la tombée de la nuit. Les gouverneurs de trente États ont mobilisé 24 000 membres de la Garde nationale et début juin, 11 000 personnes avaient été arrêtées, un chiffre qui peut paraître relativement faible et indiquer à quel point la police a pu être dépassée au plus fort des émeutes. Pour la première fois depuis des décennies, les forces de police dans des villes comme Los Angeles, New York et Chicago, véritables armées miniatures, ont manqué de personnel pour contrôler les foules. Le fleuve en crue débordait ses rives, détruisant les voitures de police par dizaines. Des milliers de personnes ont affronté le Secret Service devant la Maison blanche, alors que les incendies dans les alentours semblaient sur le point de contraindre Trump à quitter la ville. Un hélicoptère Black Hawk de la Garde nationale du District de Columbia, sous les ordres directs du Président, s’est positionné à une proximité assourdissante de la foule, rappelant aux insurgés, au cas où quelqu’un l’aurait oublié, qu’ils pouvaient si nécessaire nous descendre par dizaines et qu’ils étaient prêts à le faire.
Dans l’ensemble, pourtant, la police a été contrainte à reculer, se regrouper, se concentrer sur la défense des commissariats et l’escorte des camions de pompiers. Et cela impliquait qu’elle ne pouvait plus user de son sortilège hypnotique, qu’elle ne pouvait plus garantir les droits des détenteurs de la propriété privée. Les pillards se sont lentement mis à l’œuvre, sachant que pour un bref moment les villes étaient à eux. Pour citer quelques exemples : à Philadelphie, au moins un groupe circulait dans des véhicules, faisait sauter des distributeurs automatiques et récupérait l’argent. A San Leandro, une banlieue au sud d’Oakland, des gens se sont introduits dans une concession Dodge et ont passé plusieurs heures à percer le coffre. Ils sont ensuite repartis avec dix-sept voitures d’une valeur totale de 1,3 million de dollars, dont un certain nombre de modèles « Hellcat » Dodge Challengers à 90 000 dollars l’unité. A Fairfield, une autre banlieue de la région de la Baie, quelqu’un a utilisé un transpalette pour forcer l’entrée d’un grand magasin d’électronique. La diffusion aux zones périphériques de ces émeutes est remarquable : San Leandro et Fairfield sont des banlieues majoritairement ouvrières, comme Ferguson, qui ont été prolétarisées et sont devenues moins blanches au cours des dernières décennies. Mais des quartiers et des banlieues plus aisés ont aussi connu des émeutes, comme Walnut Creek près de chez moi, Beverly Hills à Los Angeles et Buckhead à Atlanta, autant de lieux conçus au départ pour tenir à distance la populace. Des campagnes sur les réseaux sociaux ont explicitement incité les émeutiers à diriger leur rage sur ces quartiers plus blancs et plus aisés, ainsi que sur leurs commerces de luxe, comme cela s’était passé en 2011 au cours des émeutes londoniennes.
C’est quand elle est humiliée que la police se montre la plus dangereuse, quand elle perd. Alors qu’elle menait le combat pour reprendre le contrôle des villes, la police a tiré et abattu au moins quatre personnes (ce qu’elle a reconnu), mutilant et blessant grièvement de très nombreux autres. A Oakland, la police d’État, en cherchant à récupérer une des voitures Hellcat volées, a tiré des dizaines de fois sur le véhicule où se trouvait Erik Salgado, 23 ans, blessant sa petite amie enceinte, ce qui a conduit à la mort de l’enfant à naître. À Vallejo, une autre banlieue de la zone de la Baie, les policiers ont répondu à l’annonce d’un possible pillage de pharmacie en fonçant en voiture sur Sean Monterrosa, 20 ans, qui s’était mis à genoux pour ne pas être abattu. Ils ont affirmé avoir confondu le marteau qu’il tenait à la main avec une arme, raison qui les aurait amenés à lui tirer dessus et le tuer, déchargeant leurs puissants fusils à travers le pare-brise de leur camionnette avant même de s’arrêter. A Louisville, la police et la Garde nationale étaient en patrouille dans une rue quand ils ont éteint leurs caméras portatives et ouvert le feu sur une foule, tuant David McAtee, qui tenait un stand de grillades à cette intersection. De nombreuses personnes ont été éborgnées ou fortement commotionnées par des balles en caoutchouc, des cartouches de gaz lacrymo ou d’autres projectiles : un fil Twitter populaire regroupant les exemples de brutalité policière au cours du soulèvement dénombre plus de cinq cents vidéos. Avec l’insurrection, certains policiers se sont retrouvés pour la première fois en intervention face à des émeutiers et ils ont fait usage d’un arsenal non-létal dont ils n’avaient pas l’habitude. Ils ont été confrontés à des gens qui avaient de bonnes raisons de les haïr et qui le leur ont bien fait comprendre. Cela a donné lieu à une violence gratuite, mauvaise et revancharde.
Dans les rues, les émeutiers doivent se soucier de la violence exercée non seulement par la police, mais aussi par les adeptes de l’autodéfense et d’autres miliciens de droite. Dans ses déclarations publiques lors des premiers jours du soulèvement, Trump a incité à mots couverts ses supporters à manifester leur soutien à la police, et ils ont répondu à l’appel d’une façon atroce. Les voitures constituent à présent des armes de prédilection : les suprématistes blancs et l’État islamique ont su démontrer leur efficacité aux yeux du monde entier. Les fascistes et les nationalistes blancs parlent d’écraser les bloqueurs de route et échangent des plaisanteries à ce propos depuis 2014, lorsque les manifestants Black Lives Matter ont popularisé la tactique du blocage d’autoroute. Quand le fasciste James Alex Fields a renversé et tué la manifestante Heather Heyer dans les rues de Charlottesville en 2017, il a donné une grande visibilité à cette contre-tactique, et on a dénombré des dizaines de nouveaux cas de véhicules fonçant dans une foule. A Bakersfield, un homme noir, Robert Forbes, a été renversé et tué sur un blocage. Le conducteur de la voiture, couvert de tatouages nazis, a pu s’enfuir et n’a pas été arrêté, chose qui contribuera certainement à la recrudescence de ce genre d’attaque.
L’essor de Trump en 2016, couplé plus largement à un retour des fascistes et nationalistes blancs, marquait à bien des égards une réaction au mouvement Black Lives Matter de 2014-2015. Quand Trump évoquait lors de son discours d’investiture un « carnage américain » au cœur des zones urbaines, il s’agissait d’une référence à peine voilée à Baltimore et Ferguson, et à la crainte de la révolte noire qui en constituait le cœur, même si ses diatribes prenaient généralement pour cibles les musulmans, les immigrants venus du Mexique et d’Amérique centrale. Il a fallu quelques années pour que cette réaction raciste et fasciste se développe une première fois, mais à présent la rébellion noire fait face au racisme anti-noir, ce qui a un effet déterminant sur l’espace tactique dans lequel ces rébellions se déroulent, puisque les participants doivent dorénavant compter avec l’éventualité de se faire tirer ou foncer dessus.
Songez à ce qui s’est passé à Seattle début juin. Suite à la mise en place du couvre-feu et du déploiement de la Garde nationale, une espèce de citoyen en colère a précipité sa voiture dans la foule qui se trouvait devant le poste de police de l’Est de Seattle. Quand les gens ont essayé de l’extraire de son véhicule, il a tiré sur l’un d’entre eux, est sorti de la voiture, brandissant son arme, avant de se rendre à la police, qui l’a placé en détention. À la suite de quoi la foule enragée est devenue si virulente que tous les officiers de police ont reçu l’ordre de quitter le commissariat, offrant une nouvelle image de policiers humiliés contraints à se retirer d’un de leurs sanctuaires. Cette fois-là, personne n’a mis le feu au poste, mais des barricades ont été érigées aux alentours, déclarés Zone autonome de Capitol Hill (ZACH), les barricades étant justifiées par le risque de violence de la part de la police et l’extrême-droite. On comprend facilement que les barrières orange de chantier, les planches de contreplaqué et les blocs de béton surveillés par des rebelles en armes constituent le minimum de violence défensive nécessaire lorsqu’on se trouve entouré de fascistes à la recherche d’une occasion de tuer, avec une arme ou une voiture. La solidité de la zone autonome barricadée était uniquement le fruit de sa nécessité.
Quand le soulèvement a commencé à décliner dans les autres villes, l’image de radicaux noirs armés sur les remparts du centre-ville de Seattle a mis en émoi les médias conservateurs et par conséquent Trump, dont les tweets rageurs faisaient largement suite à ce qu’il voyait à la télé. Le parti de l’anarchie comme celui de l’ordre avaient tous deux de bonnes raisons d’exagérer la portée et la profondeur de la rupture introduite par la ZACH — Fox News faisait des reportages depuis l’intérieur de ces six pâtés de maisons comme s’il s’agissait vraiment d’un territoire étranger ayant fait sécession des États-Unis. En conséquence, et quoi qu’ait pu représenter cette zone, Trump lui a déclaré la guerre, la désignant comme cible pour tous les jobards suprématistes blancs dans un rayon de 150 km (la côte pacifique du nord-ouest des États-Unis n’en manque pas). Au cours des nuits et semaines qui ont suivi, il y a eu plusieurs tirs et attaques de véhicules dans ou à proximité de la ZACH et, bien que les circonstances demeurent floues, des suprématistes blancs étaient apparemment impliqués dans certains cas.
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il peut être difficile de rapporter ce qui se passe, en particulier pour ceux qui essaient de suivre et qui sont loin. Les pourvoyeurs en nouvelles, fragilisés par des vagues de licenciements dues à la baisse des rentrées publicitaires et confrontés à un foisonnement de sujets de premier ordre (la pandémie, l’effondrement économique, la rébellion) disposent souvent de peu d’informations utiles et ne rendent pas compte de la majeure partie des émeutes. Les participants et les témoins se tournent plutôt vers les réseaux sociaux et les applications de messagerie, où l’on peut trouver des informations réelles sur ce qui se passe, mêlées à tout un fatras d’indécrottables théories du complot et de racontars. Les rumeurs les plus courantes et les plus tenaces évoquent la présence de malfaiteurs blancs — que ce soit des anarchistes profitant de la situation, des flics blancs en civil s’adonnant à l’émeute pour décrédibiliser un activisme sinon pacifique, ou de sinistres proto-milices cherchant à déclencher une guerre raciale. Cette dernière rumeur a des fondements tangibles : il existe une milice informelle organisée en grande partie autour d’un mème internet, qui s’est donné le nom de Boogaloo Boys et qui est parvenue à se faire remarquer par tout le pays en jouant les wagons de queue dans les prétendues manifestations de début mai pour la « réouverture ». Ces rassemblements étaient le fait de petits commerçants en faillite, armés jusqu’aux dents, qui ont envahi les parlements du Midwest pour exiger l’assouplissement des mesures de distanciation sociale rendues nécessaires par le Covid-19. Lorsque les émeutes George Floyd ont commencé, les Boogaloo Boys, dont les chemises hawaïennes n’ont d’autres explication que des mèmes incongrus, y ont pris part en exprimant ouvertement leur solidarité, rejoignant le combat commun contre la tyrannie policière. Leurs motivations laissaient cependant à désirer. Un de mes amis, qui réside à proximité d’une grande ville du Midwest, parle d’au moins trois groupes munis d’armes à feu, outre la police : les Boogaloos, une émanation du New Black Panther Party, et un club de tir anarchiste, sans parler de ceux des participants qui étaient armés, juste parce qu’ils sont du genre à être armés. Mon ami m’a rapporté qu’à cette occasion, on a sommé les Boogaloos de reprendre en chœur le slogan « Black Lives Matter ». Ils l’ont fait et on leur a permis de rester. Dans d’autres cas, cependant, les Boogaloos ont refusé d’entonner le slogan et ont été contraints de partir.
À Minneapolis, certains de ces francs-tireurs Boogaloos se sont mis en position devant des boutiques quand le pillage a commencé, endossant le rôle de vigiles informels, comme l’ont fait certains groupes issus de milices noires. Si l’on passe en revue ces groupes rassemblant des héros en herbe aux chemises colorées, on constate que leur haine de l’État tient au fait que celui-ci empêcherait le déroulement d’une guerre raciale salutaire. Même si ces amoureux du flingue ne sont que des bouffons, ils ne sont pas totalement dépourvus de sérieux. À Oakland, lors de la première nuit d’émeute, alors que les gens s’en prenaient à un immeuble de l’administration fédérale, deux hommes proches des Boogaloos sont passés au ralenti dans un van blanc, ouvrant le feu sur des gardes du bâtiment et tuant l’un d’eux. La présence de semblables pseudo-alliés dangereux met nombre de gens en alerte et ce, à juste titre ; plus dangereux encore sont les fascistes et les nationalistes blancs qui ne prétendent pas à une quelconque neutralité : des dizaines de gens se sont fait tirer dessus et attaquer à proximité des manifestations, et étant donné le chaos et le flou qui entourent l’insurrection, les fascistes sont très clairement en train de tuer des gens sans être inquiétés.
Tout cela a amené à se poser des questions sur la présence de Blancs dans les émeutes et à une fixation sur la figure de « l’anarchiste blanc », généralement impliqué en paroles ou en actes dans les émeutes anti-police du XXIe siècle. On pense tantôt que les Blancs qui allument des incendies ou brisent des vitrines sont des provocateurs au service de la police, tantôt qu’ils ne sont que des idiots nihilistes cherchant à profiter de la situation, mais le préjugé implicite est qu’on pourrait distinguer entre les tactiques suivant la couleur de peau. Parce que la destruction des biens ou la violence sont de mauvaises actions, les bonnes personnes de la bonne couleur de peau ne peuvent pas en avoir été responsables. Le matin qui a suivi la destruction du troisième commissariat de Minneapolis, des dizaines de milliers de gens ont fait circuler l’image d’un grand homme blanc tout de noir vêtu occupé à briser les vitrines d’un AutoZone (un magasin de pièces détachées). On a pu lire plusieurs argumentations démontrant qu’il devait être un flic (il était imposant, disait-on, portait du noir, de grosses chaussures, exactement comme un flic). Deux semaines plus tard, à Atlanta, une zone déjà très remuante occupée par la Garde nationale, la police a tué Rayshard Brooks, un homme noir qui dormait dans sa voiture sur le parking d’un Wendy’s. Après que les émeutiers ont convergé sur le fast-food la nuit suivante et l’ont brûlé, quelqu’un a mis en ligne depuis un compte douteux une vidéo montrant une femme blanche à l’origine de l’incendie. « Regardez cette fille blanche », disait la personne qui filmait. « Regardez la fille blanche qui essaie de cramer le Wendy’s. C’était pas nous. » Quelques jours plus tard, grâce à cette vidéo, la police a arrêté la copine blanche de Rayshard Brooks, Natalie White, qui est dorénavant inculpée d’incendie volontaire pour avoir censément participé à ce qui a été décrit dans un remarquable compte rendu des événements, comme « un élan collectif ».
Même Trump a joué la carte raciale dans son discours, déclenchant un alignement contre-nature, même s’il a été de courte durée, entre notre Président revanchard, les bourgeois blancs de gauche et les professionnels de la contestation, qui avaient tous intérêt à faire circuler des images de manifestations noires pacifiques perturbées par des anarchistes blancs. Aiguillonnées par les tweets obsessionnels de Trump, les forces de l’ordre fédérales se sont intensément concentrées sur l’« Antifa », une figure dont elles forcent les traits, comme le font les médias, pour désigner un important groupe terroriste formellement organisé, là où rien de tel n’existe. Quoi qu’il en soit, l’antifascisme réellement existant qui a joui d’une certaine visibilité avec l’élection de Trump il y a trois ans n’a joué qu’un rôle mineur dans la direction ou l’organisation des actions de l’été et les multiples procédures juridiques en cours ne déboucheront que sur une poignée de condamnations, et non sur la grande conspiration sur laquelle s’appuie le récit fédérateur. Toute la puissance de l’arsenal juridique fédéral a été déployée contre les émeutes, et les nombreuses infractions qui auraient normalement été jugées au niveau des États, où les sanctions et l’application des peines sont plus modérées, font l’objet de procédures criminelles fédérales. Des dizaines de personnes risquent des dizaines d’années de prison, voire la perpétuité, pour des choses comme l’utilisation d’un cocktail Molotov contre une police de voiture vide. Trump, comme tout bon fasciste en puissance, a fini par trouver la menace gauchiste face à laquelle camper un Mussolini crédible, et parsème dorénavant ses discours de la longue liste des ennemis d’État : « les anarchistes, les agitateurs, les pillards ».
Du fait de l’étendue et de la rapidité du soulèvement, surchargeant des circuits déjà surchargés, il n’existe pas d’endroit où recueillir les noms de ceux qui sont morts ou qui ont été gravement blessés, pas d’analyse combinée de l’identité des inculpés et des motifs d’inculpation, pas de répertoire centralisant l’information pour ceux qui se retrouvent face à des accusations importantes au niveau fédéral. Il est par conséquent difficile de contrer facilement et rapidement les allégations fantasques à propos d’agitateurs extérieurs, ou sur la composition raciale des foules, en particulier quand on parle de dizaines d’émeutes, pas seulement d’une ou deux. Quand les agences de presse ont procédé à la recension des personnes arrêtées, généralement après que le maire ou le gouverneur a déclaré qu’il s’agissait uniquement de personnes extérieures à l’État, elles n’ont pas trouvé confirmation de ce fait. Avec les informations sur les arrestations dont on dispose, on peut confirmer ce que j’ai observé et ce que beaucoup personnes présentes vous diront : il s’agissait d’émeutes multiraciales, majoritairement noires dans de nombreux endroits, composées en grande partie de jeunes en âge d’être au lycée — autrement dit, précisément ce à quoi on peut s’attendre si on se représente un soulèvement anti-police d’ampleur composé de ceux qui ont de bonnes raisons de détester la police, et qui ont subi de plein fouet la pandémie et l’effondrement économique. Répondant au New Yorker sur l’incendie du Wendy’s, Marty X confirme plus ou moins : « Je ne vais pas accorder tout le mérite aux Blancs. Les Noirs étaient en colère. Nous étions organisés. Il y avait des artificiers là-bas, parmi les révolutionnaires. Ils avaient des feux d’artifice — ils s’en servaient pour signaler l’arrivée de la police, les points de rendez-vous. Il y avait aussi des équipes anti-drones venues d’autres parties du monde : du Venezuela, de Seattle, de Minneapolis. Des gens sur le terrain, reprenant en chœur le crédo sur la suppression des financements à la police. J’ai vu des lasers assez gros pour être montés sur des télescopes qui étaient pointés sur les drones, brouillant leurs communications. »
Nul besoin d’invoquer un complot pour expliquer pourquoi une personne blanche casse la vitre d’une voiture de police au cours d’une de ces émeutes — l’outrage suffit, tout comme une longue liste de blessures et d’insultes commises par la police, et aussi tout comme le désespoir et la rage généralisés dans une période de pandémie et de crise économique. La direction d’une émeute excède les questions de personnes, de savoir qui brise telle ou telle vitrine ou conduit la manifestation vers l’autoroute. Il s’agissait d’émeutes menées par des Noirs dans un sens plus que personnel : elles étaient sous la direction du chagrin, des voix, des idées des Noirs, comme en témoignent encore les fresques peintes sur les panneaux de contreplaqué qui recouvrent les vitrines brisées dans des dizaines de centres-villes.
Ce qui est certain, malgré toutes les fausses rumeurs, c’est que la facilité dont font preuve les commentateurs états-uniens dans leur classification des événements en fonction de préjugés raciaux trouve un écho dans des communautés politiques profondément ségréguées, chez qui toutes sortes de récits imaginaires capables de s’auto-alimenter peuvent faire souche. Quoi qu’il en soit, les mêmes forces partisanes qui ont trouvé le moyen d’aller de l’avant en juin, en juillet et en août sont parvenues à dire ce qu’elles sont et en quoi elles croient à celles et ceux qui sont disposés à prendre le temps de lire les graffitis apparus sur les murs. Après la première explosion à la mi-juin, ce travail de clarification a été primordial et les émeutes se sont concentrées plus particulièrement sur des actes iconoclastes, en commençant par les statues confédérées dans le Sud, avant de s’attaquer à d’autres monuments représentatifs de la suprématie blanche.
À San Francisco, par exemple, bien éloignée des hauts lieux de la guerre de Sécession, les parcs et les esplanades sont parsemés de monuments dédiés à la colonisation espagnole et à la colonisation anglaise qui a suivi. Quand les statues ont commencé à tomber dans d’autres villes début juin, la ville a pris les devants en abattant le mur de Christophe Colomb à North Beach, haut de 4 mètres, après avoir appris qu’il était la cible d’une manif. Ça n’a pas arrêté la jeunesse iconoclaste qui s’est rendue au Golden Gate Park et a mis à bas la grande statue de Junipero Serra, le prêtre du xviiie siècle ayant bâti l’archipel de prisons et de forteresses militaires disséminées tout au long de la côte californienne, où furent torturés et réduits en esclavage des dizaines de captifs indigènes originaires de dizaines de tribus différentes, et qui constitua le canevas architectural pour la plupart des institutions de l’État. Leur cible suivante a pourtant été la statue de Ulysses S. Grant, le chef militaire responsable de la défaite du général Robert E. Lee, qui mit un terme à la guerre de Sécession et, quatre ans plus tard, engagea la reconstruction du Sud, réprima le Ku Klux Klan et fit pression pour l’adoption du quatorzième amendement (qui garantissait explicitement les mêmes droits juridiques aux ex-esclaves). Il ouvrit aussi l’Ouest américain à la colonisation sauvage, déclarant dans les faits la guerre aux nations tribales des Grandes plaines et de l’Ouest.
Là où les commentateurs de gauche voient des excès sans discernement, des actions nihilistes, des choses brisées sans égard pour leur signification historique, ils ignorent souvent la pensée en actes du mouvement, élaborée sur le moment. À San Francisco, les foules qui ont mis à bas les statues non-confédérées de Ulysses Grant, de Francis Scott Key et d’autres, ont justifié explicitement leurs actions en inscrivant sur les piédestaux des épithètes comme autant d’explications, alors que les gens de l’assistance débattaient avec les passants des questions soulevées par ce geste. En rejetant les commémorations de la violence de la colonisation et de l’esclavage des plantations, en établissant des liens que l’histoire officielle ne tisse pas entre l’esclavage du Sud et la colonisation de l’Ouest, malgré les conflits opposant les fractions de la classe dominante dans les deux cas, de tels actes remettent l’histoire états-unienne sur ses pieds et sa mythologie sentimentale sur sa tête. Ils combinent aussi le souvenir et hissent la bannière des deux moments politiques les plus importants des années 2010, qu’on pourrait désigner par métonymie de Ferguson et Standing Rock : le premier, moment définitoire de la séquence Black Lives Matter avant 2020, et le second qui renvoie à la lutte des militants sioux Dakota avec d’autres contre le pipeline Dakota Access et qui visait directement l’infrastructure du capitalisme écocidaire.
Trump a amplifié ces associations. En réaction à la vague de statues mises à bas, il a tenu un meeting de campagne dans les Black Hills, au mont Rushmore, le site sacré des Sioux défiguré par les portraits géants des présidents Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Les manifestants indigènes ont réagi en bloquant l’entrée du site, affrontant la police puis la Garde nationale. Ici comme partout, les instincts de Trump offrent un ancrage moral au mouvement, établissant des continuités là où il n’y en avait pas. Ce faisant, il concentre sur sa personne et le gouvernement fédéral un antagonisme qui aurait pu rester plus dispersé.
C’est dans l’épisode le plus récent du mouvement, se déroulant dans la ville de Portland depuis le 4 juillet, que cela se voit le plus clairement. La ville a été le théâtre des affrontements les plus intenses entre fascistes et antifascistes depuis 2016. Face à ces intraitables émeutiers, qui pour beaucoup ont des années d’expérience de lutte contre les Proud Boys et autres groupes d’alt-right, Trump a bricolé une nouvelle police antiémeute nationale à partir des éléments des forces de l’ordre fédérales qui lui sont les plus fidèles, en particulier la police des frontières. Aux États-Unis, la séparation des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les États attribue la responsabilité du maintien de l’ordre dans les rues aux maires et aux gouverneurs, et non au gouvernement central. Les forces de police nationales, comme celles qui sont sous l’autorité du département de la Justice et de celui de la Sécurité intérieure, disposent d’une juridiction spéciale. Ils enquêtent sur des crimes spécifiques, surveillent la frontière ou arrêtent les fraudeurs fiscaux. Pourtant, en réaction aux émeutes, Trump a créé par le truchement des départements de la Justice et de la Sécurité intérieure une nouvelle police fédérale antiémeute pouvant servir à tout, composée en grande partie de patrouilleurs de la police des frontières et de Marshals, qui peuvent si nécessaire être placés sous le commandement direct de la Maison blanche. En juillet, ils se sont déployés dans les rues de Portland, contre la volonté du maire, circulant en minibus de location et enlevant des manifestants, faisant face à des foules toujours plus massives enragées par leur présence, en leur offrant un exutoire pour la haine envers Trump. Cette escalade causée par les instances fédérales a redonné un second souffle au mouvement à l’échelle nationale, comme au cours de la journée de solidarité avec Portland, le 25 juillet, qui a débouché sur des émeutes : à Atlanta, un bâtiment du département de la Sécurité intérieure a été attaqué, à Seattle, le chantier d’une prison pour mineurs a été incendié et à Oakland, les participants ont saccagé le bâtiment fédéral et mis le feu au tribunal du comté d’Alameda, le décorant de graffitis.
Autrement dit, Trump a offert une nouvelle manière de prendre pour cible le gouvernement fédéral. La séparation des pouvoirs entre les États et la capitale introduit un coupe-feu contre-révolutionnaire, protégeant le gouvernement central de l’hostilité envers la police, mais Trump a fait tomber cette protection, insistant pour que les émeutes soient vues comme un référendum portant sur sa propre présidence alors qu’il aurait pu laisser la distance entre la police et l’exécutif lui servir de protection. Il a cherché à prendre la main sur les émeutes tout comme il avait cherché à se défiler lors de l’explosion pandémique de Covid-19, peut-être parce qu’il se préoccupe maintenant moins de gouverner que de mener campagne, et moins de mener campagne pour se rallier des électeurs indécis que de donner corps et répondre aux rêves fébriles d’une base de plus en plus délirante de supporters. C’est pourquoi l’intervention fédérale à Portland et dans d’autres villes par la suite a été présentée par les médias conservateurs comme une tentative de faire face à un accroissement perceptible de la criminalité, et en particulier des meurtres, censément causé par les émeutes et l’hostilité généralisée envers la police à l’heure actuelle.
Trump a donné au soulèvement une dimension fédérale et fourni aux émeutes quelque chose à affronter, mais il joue autant un rôle d’agrégation que de désagrégation, et même s’il concentre l’antagonisme, il dissémine la prise de décision. Sa prétention à un pouvoir exécutif renouvelé tient principalement du discours : il lui manque la capacité de gouverner et il ne fait confiance à personne pour le faire à sa place. Dans les discours, il peut annoncer la naissance d’un redoutable ordre nouveau, mais dans les faits il est l’expression de l’ordre actuel — son but est de mettre la Maison blanche à nu, de vider les bureaux de l’exécutif à l’exception des agences fédérales de maintien de l’ordre et de générer une pagaille trop importante pour qu’on puisse remettre les choses en ordre. L’effondrement pur et simple du Centre pour le contrôle des maladies en mars et en avril, qui s’est avéré incapable de distribuer ou de mener ne serait-ce qu’une fraction des tests nécessaires, ainsi que le sabotage actif des tentatives des États dans la gestion de la pandémie, en sont un exemple. Le sabordage de la Poste états-unienne en est un autre : les mesures de réduction des coûts mises en place par un sbire de Trump ont causé des perturbations massives dans la distribution de courrier peu de temps avant une élection où le vote se fera en grande partie par courrier et où de plus en plus de gens sont dépendants de l’acheminement postal pour leurs médicaments et leurs fournitures essentielles. Trump est un négociateur en chef. Il enverra la police défendre sa réputation, ou générer de la contre-publicité, mais il dispose d’une capacité limitée pour diriger une contre-insurrection pleinement lancée, qui nécessiterait de disposer de personnel qualifié en poste et d’un encadrement dévoué.
Le fait que Trump amène les émeutes à graviter autour de sa personne conduit à une conséquence sous-estimée : la disparition, petit à petit, de l’abolition de la prison et de la police dans le débat populaire, alors même que cela reste plus que jamais le point d’attention des gens dans la rue. Comme on pouvait s’y attendre, au cours de l’intervention à Portland, les méchants fédéraux ont essuyé la plus grande partie du ressentiment populaire, alors que la police de la ville a eu droit à un joker. Toutes sortes de responsables municipaux au Minnesota et ailleurs, sous l’effet de l’onde de choc venue de Minneapolis, ont promis de sérieusement limiter les financements de leurs départements de police, voire de les démanteler d’une façon ou d’une autre. Mais les détails sont comme toujours déprimants et si l’on pouvait suivre toutes les nouvelles locales, on constaterait que ces élus reviennent majoritairement sur leurs déclarations d’hier, qui se révèlent à présent en grande partie des discours de principe, une reculade face aux clameurs d’une populace dangereuse ou une tentative de requalifier des projets d’austérité qui étaient déjà dans les tuyaux suite à l’effondrement des rentrées fiscales.
« Abolir la police » et « abolir les prisons » sont des slogans puissants parce qu’ils présentent sous forme de formules simples ce qui ne peut être accompli que par une réorganisation révolutionnaire totale de la société. Le capitalisme nécessite la police et les prisons pour pouvoir préserver le grand mensonge de la propriété privée — dans le capitalisme, le mieux qu’on puisse obtenir ce sont des flics et des taules sous un autre nom : des bracelets électroniques, des drones et des forces de sécurité privées. De tels slogans proposent le contraire de la prétendue « revendication de transition », qui présente un but censément atteignable mais qui ne l’est pas et par conséquent, selon la théorie, dévoile le système capitaliste tout en renforçant la puissance de classe. Ces slogans, eux, présentent des actions révolutionnaires clairement maximales, des énoncés qui ne sont clairement pas adressés à la classe dominante, qui ne peuvent être accomplis que par le travail de démolition entrepris par l’insurrection prolétarienne, et ce comme s’ils étaient des revendications, pour le plein emploi, l’assurance-maladie, etc. Il ne s’agit pas d’un syllogisme, comme dans la réforme non-réformiste, seulement d’une antinomie. Cela explique en partie comment « supprimer les financements » devient synonyme d’abolir — en avançant une revendication qui n’en est pas une, le slogan demande à être remplacé par quelque chose que les élites dirigeantes peuvent effectivement faire. De nombreuses organisations, dont certaines sont abolitionnistes, demandaient déjà avant le soulèvement aux institutions locales et nationales de limiter les incarcérations, les fonds et le pouvoir accordés à la police. La traduction des appels à l’abolition lancés par la rue en appels à limiter les fonds dans les conseils municipaux est le résultat, dans bien des cas, d’initiatives et de groupes déjà existants, qui sont en position de pouvoir négocier au nom de ces mouvements et, dans bien des cas, de les pacifier en échange de concessions superficielles.
Quoi qu’il en soit, la police a été réellement affaiblie, en particulier dans les villes à majorité démocrate où les autorités de gauche ont pris des mesures pour restreindre le pouvoir de la police suite à la fureur populaire, comme à Portland, Minneapolis ou Oakland. Ces restrictions sont généralement superficielles ou inefficaces, mais elles peuvent avoir un effet sur le moral des policiers, ce qui, à long terme, peut contribuer davantage à limiter la violence policière que les coupes budgétaires. Les policiers affirment, par le biais de leurs représentants, que ces mouvements les rendent moins disposés à arrêter et à frapper les gens parce qu’ils craignent d’être suspendus, licenciés ou poursuivis. On ne peut qu’espérer que ce soit vrai, tout en gardant à l’esprit qu’il est dans l’intérêt de la police et du parti de l’ordre de surestimer la criminalité, d’exacerber provisoirement les peurs, tout comme il est dans l’intérêt des prolétaires d’exploiter les faiblesses de la police.
Il faudra d’autres commissariats brûlés avant qu’un tel affaiblissement soit perceptible. L’urgence ne manque pas. A la prison de San Quentin, à 15 kilomètres d’ici, où s’est formé le premier chapitre de prisonniers du parti des Black Panthers autour de Georges Jackson, deux mille prisonniers ont été testés positifs au Covid-19 et quatorze sont décédés. A Santa Rita, la prison locale où sont conduits les émeutiers, on dénombre à présent des centaines de cas. Le plus long et le plus torride des mois d’août se déroule en ce moment, alors que des maires et des gouverneurs appliquent à contrecœur un second confinement, anéantissant les espoirs d’amélioration, et conduisant des dizaines de milliers de patrons à une faillite certaine. Après que l’économie états-unienne a plongé dans l’abysse en mars et en avril, le nombre d’emplois créés en mai et juin dépassait ceux qui étaient perdus ; nombre de ces emplois vont maintenant disparaître pour de bon, et les chiffres les plus récents du mois d’août montrent que les demandes d’aide hebdomadaires d’assurance-chômage continuent à grimper, dépassant le million. Les actions de la classe dirigeante ne peuvent plus être comprises au prisme d’une visée à long terme, et ici, là-bas et partout, elles attisent en pratique la révolte populaire. Peut-être que certains ne voient aucun futur sinon le bastion quelconque dont ils peuvent se prévaloir face à l’effondrement. C'est peut-être simplement à cela que ressemble l'affaiblissement de la capacité d'action collective de la classe dirigeante — prendre le chemin de son lieu de villégiature alors que l'assurance chômage des plus pauvres touche à sa fin et que la charge virale explose dans une dizaine de zones métropolitaines.
La résilience dont ont fait preuve les États-Unis et l’ordre économique d’après-guerre dont ils ont été les superviseurs devraient inciter fortement à la prudence ceux qui s’empressent de vouloir signer le certificat de décès du pays. Mais les signes et les symboles de la guerre civile actuellement en circulation dans les rues viennent confirmer une thèse exposée en premier lieu par W.E.B. Du Bois, dans son ouvrage Black Reconstruction in America, qu’il faut maintenant poser comme axiome : la révolte noire, tout d’abord contre l’esclavage, puis son prolongement et son extension, se situe à la racine de tout ce que peuvent accomplir les prolétaires ou la classe ouvrière aux États-Unis. La défaite de la Reconstruction dans le Sud, qui pour Du Bois aurait pu fournir la base d’un dépassement du capitalisme américain, ne se situe pas dans le passé mais se rencontre à chaque cycle de luttes, jusqu’à ce que l’émancipation soit totale et qu’il ne reste plus aucun commissariat. C’est la tâche à laquelle invite la rébellion George Floyd, transformer une crise économique et sanitaire sans précédent en crise politique, convoquant les esprits de toutes les générations pour l’heure de vérité trop longtemps attendue.