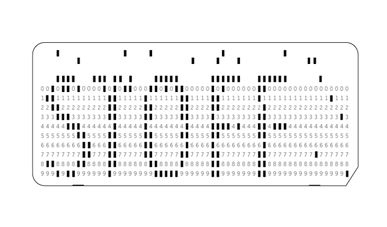Par le passé, le cercle réuni autour de la revue Krisis, auquel appartient également Norbert Trenkle, a défendu que le propre de sa critique était de se concentrer sur la forme de socialisation médiatisée par la valeur. C’est en cela que ce cercle se différencie de nombreux autres groupes qui se disent « de gauche ». Comme il se doit pour une controverse en bonne et due forme, je vais adresser dans ce qui suit une vive critique à l’égard du groupe Krisis et de Trenkle. Il convient cependant de ne pas oublier que cela a lieu sur un fond commun. Je m’appuierai sur l’exposé de Norbert Trenkle, paru dans Streifzüge 3/1998[1b].
Valeur et échange
Norbert Trenkle soutient dans son texte que le « travail » n’est pas une condition anhistorique de la vie humaine mais une forme historique particulière de l’activité vitale humaine qui s’impose avec la généralisation de la production marchande. « Le travail » est considéré par Trenkle comme une activité séparée de tous les autres domaines de la vie et soumise à un régime temporel abstrait, et de ce fait, elle serait elle-même déjà une abstraction (c’est-à-dire, déjà avant la différenciation entre travail concret et abstrait). On ne peut qu’être en accord avec lui et il est également juste de dire que cette acception n’apparaît pas de manière claire dans le Capital, mais qu’elle est bien plutôt dissimulée derrière la conception marxienne du travail (utile) comme « nécessité naturelle éternelle »[2]. Et cette critique de la conception largement répandue dans le marxisme selon laquelle le « travail » produirait de la valeur exactement de la même manière que le boulanger produit des petits pains, est tout à fait justifiée[3].
La suite de l’argumentation de Trenkle, qui se veut critique à l’égard de mon livre La Science de la valeur, n’en est que plus étonnante. Dans mon livre, j’ai notamment essayé de montrer que les concepts fondamentaux de la théorie marxienne de la valeur sont caractérisés par certaines ambivalences, et donc aussi son concept de travail abstrait constitutif de valeur. D’une part, on trouve un « concept naturaliste » qui appréhende le travail abstrait comme une dépense de force de travail humaine dans un sens « physiologique »[4]. Tout comme le boulanger façonne ses petits pains, ce travail « produit » de la valeur indépendamment de tous les processus d’échange, en la conférant ainsi par avance à chaque produit singulier. D’autre part, il y a chez Marx un concept « social » du travail abstrait. Dans ce cas, le travail abstrait ne repose pas sur des attributs « naturels » « du » travail (« la dépense productive de matière cérébrale, de muscle, de nerf, de main, etc. »[5]), mais bien plutôt sur un rapport de validation déterminé socialement : dans l’échange, les différents travaux valent comme identiques, ce qui est seulement possible quand il est fait abstraction de leur différence réelle. Le travail abstrait ne dépend donc pas de propriétés « naturelles » « du travail », mais d’une fonction qui lui est attribuée sous des rapports sociaux déterminés, ce qui n’est possible que lorsque « marchandise » est conjuguée au pluriel[6].
Trenkle rejoint bien la tendance naturaliste que je critique chez Marx lorsqu’il affirme qu’il est essentiel de considérer que les produits possèdent déjà un caractère de valeur avant l’échange[7]. Si je ne me trompe pas, Trenkle le fonde essentiellement à partir de deux arguments : premièrement, la production capitaliste n’a pas lieu dans le vide, elle est toujours déjà orientée vers le marché. Personne ne dit le contraire. Reste à savoir si le projet de valorisation du capitaliste et la forme correspondante d’organisation de la production suffisent déjà à attribuer une objectivité de valeur au produit, ou s’il ne l’obtient que dans un contexte social[8].
Dire que la valeur n’apparaît sous sa forme de valeur d’échange qu’au niveau de la circulation, cela présuppose déjà qu’elle ne prend pas naissance à cet endroit, comme le pensent Sohn-Rethel et d’autres théoriciens de l’échange et tous les représentants de la théorie subjective de la valeur. C’est présupposer, donc, qu’il y a une différence entre l’essence de la valeur et ses formes d’apparition.[9]
Il me semble qu’il y a là tout d’abord une certaine confusion de catégories. En partant du « lieu » d’une « forme d’apparition » (la valeur apparaît dans la sphère de la circulation), on tire la conclusion que l’essence qui apparaît là doit avoir « pris naissance » à un autre endroit (dans la sphère de la production) : des différences entre des catégories logiques sont simplement assimilées à des différences issues d’une métaphore spatiale.
Il est cependant plus important encore de remarquer que Trenkle en vienne même à poser cette question : « Où la valeur prend-elle naissance ? ». Cette question a déjà été posée de manière explicite ou implicite aussi bien par l’économie politique classique que par la théorie subjective de la valeur. La première a répondu, « dans la sphère de la production », et la seconde, « dans la sphère de la circulation ». Au contraire chez Marx (aussi longtemps qu’il n’argumente pas de manière « naturaliste »), il est clair que cette question découle d’une des manières de poser le problème qui repose sur un fétichisme de la production marchande. Ainsi que Marx l’expose dans l’analyse de la forme-équivalent, ce qui est valable pour l’objectivité de la valeur, c’est l’identique : il s’agit d’une propriété qu’une chose se voit attribuée quand elle est dans un rapport déterminé avec une autre chose. Et puisque normalement, les propriétés des choses ne surgissent pas dans leur rapport les unes aux autres, mais qu’elles sont déjà données à l’avance, il semble qu’elles possèdent ces propriétés indépendamment de ce rapport[10]. L’illusion consiste à considérer que les marchandises reçoivent leur objectivité de valeur isolément, indépendamment de la société, et c’est par cette illusion que l’on transforme une propriété sociale en une propriété naturelle. C’est pourquoi la valeur ne « naît » pas quelque part, pour être ensuite « là ». La valeur, c’est bien plutôt la réflexion d’un rapport social spécifique dans un objet. Cela fait entièrement sens de se demander pour des petits pains d’où ils « proviennent », de l’arrière de la boulangerie ou d’une usine. Mais croire que l’on peut venir à bout de la valeur avec cette même question trahit que l’on pense le travail comme produisant de la valeur de la même manière que le boulanger produit des petits pains.
Mais pourquoi cette question est-elle si importante qu’il faille vous torturer autant avec elle ? Il s’agit en fait d’analyser et de comprendre la spécificité de la socialisation qui règne dans la société bourgeoise. Il existe entre les producteurs (dans les conditions capitalistes : les entreprises capitalistes) une interdépendance générale, et en même temps ces producteurs sont indépendants les uns des autres, la production est « privée ». C’est seulement par après que cette « production privée » devient une composante de la production sociale et ce, dans un processus médiatisé par l’argent (et sa forme développée, le crédit). Si l’on attribue cette objectivité de valeur au produit en la situant déjà au niveau de la production privée, alors on lui confère quelque chose de social en soi, et la médiation par laquelle la production privée est reconnue comme étant sociale ne devient donc qu’un phénomène purement marginal. Mais, justement, les formes de cette médiatisation posent des problèmes théoriques décisifs : les nombreuses contributions à l’analyse de la forme-valeur et le chapitre inachevé (et qui, peut-être, est inachevable sur la base depuis laquelle Marx réfléchit) sur le crédit dans le Livre III du Capital le montrent clairement. En conséquence, ces parties ardues de la critique de l’économie politique marxienne furent largement ignorées dans le marxisme « classique » du mouvement ouvrier, qui, de même que Trenkle, estime que l’objectivité de valeur des produits est déjà donnée avec la production capitaliste[11].
Taux de profit, travail productif et crise
Dans ses très rares développements sur la crise, Trenkle fait référence à la fameuse thèse de l’effondrement du groupe Krisis selon laquelle « la production marchande moderne est entrée dans un processus de crise fondamental qui ne peut aboutir qu'à sa chute », mais les justifications qu’il fournit sont tout au plus suggérées.
Cependant, les théories de l’effondrement n’ont rien de nouveau. Avant 1914, elles faisaient tout autant partie du noyau idéologique du « centre marxiste » constitué dans le SPD autour de Bebel et Kautsky, que de celui de son aile gauche constituée autour de Rosa Luxemburg (même si ces théories avaient des fonctions politiques différentes : au centre, elles servaient à justifier un « attentisme révolutionnaire », on attendait le « grand badaboum » (Bebel) en condamnant toute action révolutionnaire passée comme étant « volontariste » ; chez Rosa Luxemburg, la théorie de l’effondrement avait au contraire une fonction mobilisatrice, la gauche ayant ainsi non seulement la marche de l’histoire de son côté, mais surtout la tâche d’empêcher, par une révolution, l’avènement de la barbarie accompagnant l’effondrement). Les partis communistes des années 1920 et 1930 tenaient aussi à la théorie de l’effondrement : Lénine avait déjà qualifié l’impérialisme comme ce qui caractérisait le capitalisme dans sa phase sénile, déjà sur le déclin. Et lorsque, dans les années 1920, ce capitalisme se fut indéniablement rétabli, en ayant même provoqué un développement accéléré des forces productives, et ce malgré la prédiction de sa stagnation, des auteurs comme Eugen Varga durent improviser une théorie de la « crise générale du capitalisme », permettant d’interpréter chaque sursaut comme la dernière convulsion avant le déclin final (lui-même accéléré par le dernier sursaut !).
Lorsque le marxisme, dans le sillage des mouvements étudiants à la fin des années 1960 et dans les années 1970, connut un regain d’intérêt en Europe de l’Ouest, d’autres théories de l’effondrement furent élaborées (comme par Ernest Mandel). Elles n’eurent cependant pas le même écho qu’auparavant. Dans les années 1980, elles avaient largement disparu jusqu’à ce qu’elles soient finalement sauvées de la noyade par Robert Kurz et la revue Krisis. Et au regard des nombreuses critiques pertinentes des limites du marxisme classique du mouvement ouvrier, il est d’autant plus étonnant que le groupe Krisis s’affuble justement de cette perle du marxisme du mouvement ouvrier. Ce qui est problématique dans les anciennes théories de l’effondrement, tout autant que dans leur récent revival, c’est « l’effondrement » lui-même : quel état de la société devons nous nous représenter avec ce terme ? Misère et chômage de masse généralisés ? Quelle est alors la différence avec une crise « normale » ? Ou alors s’agit-il véritablement de la fin de la production marchande ? Je ne peux pas identifier de réponse univoque à ces questions dans la contribution de Trenkle. D’une part, il est question, comme cité plus haut, de la « chute de la production marchande », c’est-à-dire de la disparition effective de ce mode de production. D’autre part, il aurait été montré « théoriquement et empiriquement » « qu’aucun nouveau sursaut séculier d’accumulation n’aura lieu, que le capitalisme est irrémédiablement entré dans une époque barbare de déclin et de délitement »[12]. Dans ce cas, il y aurait toujours une production marchande et le capitalisme perdureraient, mais en stagnation et avec des conséquences sociales effrayantes.
Trenkle expose trois arguments (et pour certains, ils sont aussi développés dans d’autres textes du groupe Krisis) qui pourraient rendre plausible, certes non pas une « chute » finale de la production marchande, mais peut-être un déclin « irréversible » du capitalisme : premièrement, la « disparition de la substance-travail… dans les secteurs essentiels de la production du marché mondial », deuxièmement le « retrait progressif du capital hors de vastes régions du monde », et troisièmement « le gonflement et l’explosion violents des marchés de crédit et des marchés spéculatifs ».
Examinons ces arguments un par un. Le plus faible me semble être le deuxième. Supposons ici que le constat soi-disant empirique soit juste, même si l’on pourrait le remettre en question (en l’occurrence : y a-t-il effectivement d’« immenses régions du monde » qui ont déjà été capitalisées une fois et qui seraient décapitalisées qu’aujourd’hui ?). Cela ne suffirait pas pour autant à fonder la tendance globale au déclin qui est défendue. Mis à part le fait discutable que le constat soi-disant empirique d’un tel repli décrive quelque chose qui ait effectivement lieu (autrement dit, l’existence de « vastes régions du monde » qui ont été capitalisées déjà une fois et qui ont été décapitalisées seulement aujourd’hui), une tendance à l’effondrement global ne s’en laisse pas déduire. Si l’on considère le développement du capitalisme industriel sur les 200 deux cent dernières années, on observe un constant va-et vient entre certaines régions : les territoires industriels du centre de l’Angleterre d’abord, l’industrie automobile à Detroit, la Ruhr, tous ont été des emplacements centraux du capital, qui connurent un déclin alors que de nouveaux territoires apparurent (dans la Sunbelt américaine, dans le Sud de l’Angleterre, dans le Sud de l’Allemagne) ; certains de ces anciens territoires purent s’en remettre, d’autres non. Mais cela ne vaut pas seulement pour la place qu’occupent des régions au sein d’un État nation, mais aussi pour la place occupée par des États et même par des régions du monde. Rien ne me semble indiquer qu’aujourd’hui, il ne s’agirait pas simplement de ce mouvement de va-et-vient entre différentes régions, mais que le capitalisme, après s’être étendu sur le monde entier, se serait rétracté sur des îlots (toujours moins nombreux) dans une mer de production non-capitaliste.
La situation abordée par le troisième argument (« le gonflement et l’explosion violents des marchés de crédit et des marchés spéculatifs ») a été analysée en détail par Robert Kurz dans un article de 1995[13]. À la lecture de ce texte, on a la vive impression que déjà la simple expansion des rapports créditeurs dans la production capitaliste est d’emblée comprise comme étant ce qui mine l’ensemble du mode de production, en ce que les intérêts provenant des crédits menacent de « brider » et d’« étouffer » le capital « réel ». Or Marx a déjà montré de manière assez convaincante dans son analyse (certainement insuffisante) du crédit que la médiatisation de la production par le crédit, et avec elle, la division entre intérêts et profit du capitaliste, est justement le cas normal pour un capitalisme développé. Et dans les faits, le crédit augmente considérablement la dynamique et la flexibilité du capitalisme : d’une part, l’accumulation d’un capital singulier n’est plus limitée par le profit qu’il produit lui-même, et les ressources sociales peuvent être très bien plus rapidement écoulées dans de nouveaux canaux ; d’autre part, le « bridage » du capital par le paiement des intérêts a pour conséquence qu’un capital singulier, même s’il est en dehors de rapports de concurrence, est contraint d’augmenter la force productive et de réaliser des économies de capital constant. Dans le cas du financement par crédit, une entreprise qui n’arrive plus à faire face à la concurrence constante disparaît plus vite que si elle ne travaillait qu’avec du capital propre qui lui aurait permis, encore pendant un temps, de se nourrir « de la substance ». Cette disparition accélérée peut être certes très désagréable pour les capitalistes isolés et pour les forces de travail qu’ils emploient, mais elle augmente « l’efficience » du système capitaliste dans son ensemble. Le crédit et la spéculation n’ont pas seulement pour effet de rendre le capitalisme plus dynamique et flexible, ils peuvent également déclencher des crises ou amplifier des tendances à la crise déjà existantes. Mais ces crises ont aussi une fonction décisive pour le capitalisme pris dans son ensemble. Si la « pression exercée par les intérêts » devient trop élevée, non seulement pour les capitaux singuliers, mais aussi pour la plupart des capitaux, ce n’est pas seulement le capital « réel » qui est alors mis sous pression, mais aussi le système bancaire : ses crédits deviennent « paresseux ». La « pression exercée par les intérêts » trop élevée est alors « corrigée » par une crise qui peut bien sacrifier une partie du capital industriel et du capital bancaire, mais pas le système capitaliste dans son ensemble.
Reste encore à examiner le premier argument avancé par Trenkle et qui joue un rôle important dans de nombreux textes du groupe Krisis : la « disparition du travail productif ». Si je comprends bien, alors ce sont deux lignes d’argumentation différentes qui se croisent ici. D’une part, ce sont les réflexions que Marx expose dans le cadre de sa justification de « la baisse tendancielle du taux de profit » qui sont reprises, et d’autre part, c'est un nouveau concept de travail productif qui est mis en œuvre.
Pour faire court, Marx justifie la chute à long terme des taux de profits moyens par la diminution toujours plus forte de la part de « capital variable » (avec lequel est achetée la force de travail) dans l’ensemble du capital avancé par le capitaliste, en tant que l’augmentation de la productivité nécessiterai une machinerie toujours plus coûteuse. La plus value (et avec elle, sa forme métamorphosée, le profit) ne surgit que par la dépense de force de travail vivant, de telle sorte que le capital sape la source de sa valorisation au cours de son développement, provoquant ainsi une baisse sur le long terme des taux de profit. Cette argumentation pose problème parce que le processus esquissé n’a pas seulement l’aspect mis en exergue par Marx (à savoir, l’augmentation du capital constant par rapport au capital variable), qui, considéré isolément, provoque une baisse des taux de profit. Il possède en outre d’autres aspects ayant des propriétés augmentant les taux de profit : l’augmentation de la productivité a pour effet une baisse de coût pour le capital constant avancé, et en outre une augmentation des taux de plus-value (autrement dit, une quantité identique de force de travail fournit dans le même temps une plus-value plus grande). C’est seulement de ces trois effets que résulte la fluctuation des taux de profit. Certes, les deux derniers avaient été pris en compte par Marx, mais il les considérait comme secondaires sans pour autant pouvoir suffisamment le justifier. Qui affirme qu'une chute des taux de profits a lieu (ou s’appuie dessus pour déduire une diminution du travail productif), et donc produit un énoncé d’ordre quantitatif, doit pouvoir présenter une justification quantitative (dans notre cas, il devrait être montré que le premier effet, celui provoquant la baisse des taux de profit, est quantitativement plus grand que les deux autres effets pris ensemble). L’objection souvent formulée à cet endroit selon laquelle il ne s’agit non pas de grandeurs quantitatives mais de rapports sociaux, est peu convaincante quand celui qui l’avance a lui-même auparavant argumenté au moyen de changements de grandeurs d’ordre quantitatif[14].
Mais on trouve dans le groupe Krisis encore des réflexions de tout autre nature afin de soutenir l’idée de la « disparition du travail productif ». À ce niveau, le concept du travail productif est redéfini de manière plutôt inhabituelle. Marx avait établi dans les Théories sur la plus-value que les concepts de travail productif ou improductif, pour pouvoir être mis au service d’une analyse pertinente, devaient être reliés au caractère du mode de production et non à quelques propriétés concrètes du processus de travail. Dans des rapports capitalistes, tout travail salarié n’est donc pas d’emblée « productif », mais seulement celui qui produit aussi de la plus-value. Le travail du jardinier qui entretient le jardin d’un capitaliste est improductif aussi longtemps que ce jardin sert uniquement à faire plaisir au capitaliste. C’est seulement lorsque les produits du jardin sont vendus sur le marché avec un gain que le travail du jardinier (sans que rien n’y ait concrètement changé) devient « productif ». Marx considère également comme improductifs ces travaux qui, même s’ils ont lieu dans le cadre d’une production capitaliste, ont uniquement pour objet la transformation de la marchandise en l’argent ; ces travaux, donc, qui ne sont pas déterminés par la production elle-même mais par sa forme capitaliste. Le travail improductif ne contribue pas à la production de plus-value, mais il doit être rémunéré par une ponction sur la plus-value, réduisant ainsi les possibilités de l’accumulation.
Si dans le texte de Kurz cité plus haut[15], il est fait référence aux réflexions de Marx avec une certaine justesse, on observe que l'auteur a toutefois tendance à rattacher les travaux improductifs de nouveau à certaines propriétés qui appartiennent à leur contenu concret (c’est notamment ainsi qu’il distingue la sphère des services de la production « substantielle » de marchandises)[16]. Ce qui est plus grave que ces approximations, c’est l'extension fondamentale du concept de travail productif entreprise par Kurz. Seuls pourront être qualifiés de « productifs » les travaux qui sont nécessaires à la reproduction du capital non seulement pour les entreprises particulières, mais aussi au niveau de l’ensemble de la société. Ses réflexions reviennent à dire que le travail réalisé dans une usine de pain par les forces de travail est productif pour autant que son produit (le pain) est consommé par des forces de travail, qui elles-mêmes accomplissent également un travail productif, mais qu’il n’est pas productif lorsque ce pain est consommé par des travailleurs non productifs (comme les agents d’entretien d’une entreprise). Pour qu’une force de travail soit dépensée « de manière productive », il n’est pas seulement nécessaire qu’elle produise un produit qui sera vendu et qu’un gain soit dégagé par cette vente. Cela dépend aussi de l’utilisation qui sera faite de ce produit. Un travail est productif, selon Kurz, pour autant que son produit est consommé par des travailleurs productifs (comme moyen de consommation ou de production).
Ne nous attardons pas sur l’apparente circularité de cette définition (le travail productif est défini par le travail productif)[17], mais présumons (et c’est là où veut en venir Kurz, en fin de compte) que la part de travail improductif dans l’ensemble du travail social augmente effectivement ou, au contraire, que nous pouvons observer la « disparition » du travail productif (Trenkle). Que cela suffise pour annoncer l’effondrement du capitalisme, c’est quelque chose qui resterait toutefois encore à prouver. Certes, Kurz évoque à plusieurs reprises une « limite du supportable » pour la reproduction du capital qui aurait déjà même été dépassée par l’augmentation du travail improductif ; nous attendons cependant en vain de connaître la définition quantitative d’une telle « limite du supportable ». Or comment pourrions-nous savoir si nous l’avons déjà atteinte sans avoir même une vague représentation de la définition de cette limite ?
Derrière l’argument d’une « limite du supportable » se loge manifestement une conception selon laquelle le domaine « productif » engendrant de la plus-value devrait alimenter celui qui est improductif, un domaine qui grandirait, de sorte qu’il ne resterait ensuite pas assez de plus-value pour l’accumulation dans la « production substantielle de marchandises ». Nous avons ici en fait affaire à un problème similaire à celui de la baisse du taux de profit : la productivité augmentant continuellement contribue à ce que la masse de plus-value produite par une force de travail « productive » augmente constamment, si bien qu’une force de travail « productive » peut entretenir une masse toujours plus grande de travail improductif. S’il est affirmé que le travail improductif devient un poids insoutenable, alors il faudrait au moins montrer qu’il augmente plus rapidement que la force productive (mais il faudrait encore tenir compte du fait que la « rationalisation » touche tout autant les secteurs « improductifs », c’est-à-dire que les tâches « improductives » sont réalisées avec une force de travail toujours plus réduite). En effet, ce n’est que dans ce cas que l’augmentation du travail improductif peut s’approcher d’une « limite du supportable » (quelle que soit sa définition).
Un effondrement ou un grand coup de balai par la tempête ?
Si les réflexions que nous venons de faire sont exactes, alors il n’a pas encore été prouvé que le capitalisme connaîtrait actuellement sa « crise d’effondrement ». D’un autre côté, l’existence de crises (et même, de crises de plus en plus aiguës) est indubitable. Mais quelle signification ont ces crises si elles ne mènent pas à l’effondrement du capitalisme ?
J’ai précisé, au début de mon exposé déjà, en quoi consiste la spécificité de la socialisation dans la société bourgeoise : malgré une interdépendance générale, la production est organisée de manière « privée », et c’est seulement après coup, sur le marché, que se révèle dans quelle mesure les produits privés sont reconnus comme produits d’un travail social. Comme l’affirme Marx dans le premier chapitre du Livre I du Capital, la possibilité de la crise est déjà donnée par la forme de la vente et de l’achat qui déchire ce qui constitue un tout intrinsèquement unifié. Afin d’observer comment cette pure possibilité se transforme en une véritable crise, il faut analyser le procès d’ensemble de production et de reproduction, ce que fait Marx dans le Livre III du Capital. C’est là que se trouvent, principalement dans le chapitre 15, différentes contributions de Marx à la théorie des crises[18]. Bien que ces contributions soient incomplètes et qu’elles manquent de systématicité (en particulier parce que le système de crédit n’est pas pris en compte), Marx met en évidence que les crises ne sont pas des événements « contingents » qui pourraient être conjurés par d’ingénieuses politiques économiques d’État. C’est justement le caractère « non-conscient » de la socialisation d’une part, et l’impératif de valorisation maximale du capital d’autre part, qui provoquent toujours à nouveau des déséquilibres, des contradictions et des blocages qui ne peuvent être résorbés que de manière violente, c’est-à-dire par une crise. Dans cette mesure, les crises n’ont pas qu’un effet destructeur : pour le capital dans son ensemble, elles ont une fonction éminemment positive. Plus précisément, c’est en raison de leurs conséquences destructrices que les crises ont cette fonction positive. En ce qu’elles dévalorisent les capitaux singuliers n’étant plus assez rentables, écartent des structures sociales devenue dysfonctionnelles, et que des masses de travailleuses et de travailleurs perdent leur emploi et en abaissant ainsi le niveau de reproduction du travail, les conditions de valorisation se trouvent très grandement améliorées pour les capitaux restants. Peut alors commencer un nouveau sursaut d’accumulation, qui finalement mènera lui-même à de nouvelles contradictions et de nouveaux blocages devant être surmontés par la crise suivante. Le capitalisme se comporte ici de manière semblable à une tumeur cancéreuse : même si 90 % de la tumeur est détruite, rien n’empêche le développement des 10 % restant. Ceci a même éventuellement lieu plus rapidement encore.
Pour ce qui est des processus de crises actuels, ils me semblent indiquer tout sauf la fin du capitalisme. Ainsi, ladite « crise asiatique » n’indique pas le début de la fin du capitalisme en Asie de l’Est, mais plutôt son commencement : le capitalisme d’Asie de l’Est qui avait été stabilisé politiquement durant la Guerre froide (aussi bien par les États nations isolément que par la puissance hégémonique des U.S.A.) avait, comme il est courant dans ces situations, engendré de géantes bulles spéculatives. Depuis un an et demi, non seulement ces bulles éclatent, mais le capitalisme des États appelés les « dragons asiatiques » doit aussi composer avec le fait qu’il n’est plus « l’enfant gâté » des U.S.A. Dans cette mesure, la crise asiatique a pour conséquence que le capitalisme en Asie de l’Est est ramené à un niveau de développement « réaliste », ce qui est lié pour la population à une très forte dégradation de ses conditions de vie. Le capitalisme d’Asie de l’Est va, sur cette base restreinte, mais aussi par sa propre force, pouvoir continuer à se développer et certainement bientôt devenir un concurrent bien plus redoutable pour le capital des U.S.A. et d’Europe de l’Ouest qu’il ne l’avait jamais été. Il en va de même pour l’Afrique (que Trenkle a vraisemblablement à l’esprit quand il parle d’un retrait du capital hors de régions entières du monde) qui paraît se trouver bien plutôt au début qu’à la fin d’un développement capitaliste. Avec la fin de l’apartheid en Afrique du Sud a cessé le blocus politique contraignant l’expansion de la puissance de loin la plus forte de l’Afrique. Depuis, l’Afrique du Sud ne domine pas seulement l’économie sud africaine. En effet, des entreprises sud-africaines se sont déjà implantées à côté d’entreprises américaines en Afrique centrale pour ne pas abandonner l’exploitation de cette région riche en matières premières aux seules entreprises françaises. Ces signes nous montrent plutôt un renforcement qu’un affaiblissement du développement capitaliste, même s’ils se situent à un niveau moindre et qu’ils se laissent plutôt mesurer en décennies qu’en années.
L’effondrement du socialisme dit « réel » n’est certainement pas le début de la fin de la production marchande, mais plutôt le début de quelque chose apparaissant historiquement pour la première fois : un capitalisme de concurrence « mondial ». Si la « concurrence sur le marché mondial » constitue véritablement « le fondement vital du mode de production capitaliste », comme le formule Marx dans le Livre III du Capital[19], alors ce « marché mondial » est aujourd’hui pour la première fois si développé qu’il recouvre effectivement la totalité du monde. Dans cette mesure, l’existence réelle du mode de production capitaliste est pour la première fois « adéquate à son concept ». Ce capitalisme enfin réalisé me semble être très éloigné de tout « déclin » ou de toute « chute ». Il n’aura pas non plus grand-chose à voir, selon toutes prévisions, avec les conditions assez confortables (depuis notre perspective actuelle) du « miracle économique » de l’Après-guerre. En Europe de l’Ouest et aux U.S.A. tout du moins, nous étions proches du plein emploi (du milieu des années 1950 jusqu’au début des années 1970), les salaires réels augmentaient, les prestations sociales étaient mises en place et le développement capitaliste avançait, certes de manière cyclique, mais sans être interrompu par de grandes crises. Cette situation presque idyllique (mais qui n’existait alors que dans les métropoles capitalistes et non dans les pays du prétendu Tiers monde) n’est plus à attendre, du moins aussi loin que l’on puisse prévoir. Il ne faut pas confondre la fin d’un modèle de développement particulier (souvent étiqueté des concepts « fordisme » et « Etat-providence keynésien »), dont l’existence reposait sur une série de facteurs économiques et politiques exceptionnels, avec l’effondrement du mode de production capitaliste en tant que tel. Il me semble que de nombreux phénomènes, que Trenkle impute probablement à « l’époque d’effondrement de déclin barbare » du capitalisme, appartiennent bien plutôt à son mode complètement normal de fonctionnement dont nous n’avons plus ou moins été épargnés que durant une certaine période. Et cette normalité « barbare » du capitalisme est, encore et toujours, une raison suffisante pour se soucier de son abolition.
[Pour faciliter la lecture, nous avons transformé en notes de fin les références bibliographiques et autres précisions qui sont entre parenthèses dans l’original – NdT.]
[1b] Norbert Trenkle (1998), Was ist der Wert? Was soll die Krise? in: Streifzüge 3/98.
[2] K. Marx, Marx-Engels-Werke (MEW), S. 57 ; Le Capital, Livre I, trad. J.-P. Lefebvre, Presses Universitaires de France, 1993, p. 48. Dans l’Introduction de 1857 Marx souligne lui-même que le travail compris comme une catégorie apparemment simple repose sur une abstraction. Il est pour le moins problématique que Robert Kurz (comme par exemple dans Postmarxismus und Arbeitsfetisch, in: Krisis 15) fasse de ce « fétiche du travail » un pivot de sa critique de Marx (dans la mesure où il montrerait à cet endroit sa duplicité de Janus, d’être à la fois ce qui critique et représente la « modernisation »), et de sa critique de la « modernisation » : d’une part, le concept de « modernisation » est ici repris de manière non critique de la sociologie bourgeoise (il faudrait y interroger la dichotomie entre tradition et modernité), et d’autre part on s’expose au danger de faire disparaître derrière « le fétiche du travail » les faits structurels que Marx saisit par les concepts de fétiche de la marchandise, de l’argent et du capital. [Pour un développement plus précis de la notion de modernité par Michael Heinrich, voir le début de sa biographie de Marx, Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, Tome 1, « Die Chiffre Marx », S. 17-21. NdT].
[3] Trenkle, S. 8.
[4] MEW, S. 61/Capital, p. 52.
[5] MEW, S. 58/Capital, p. 50.
[6] « C’est seulement au sein de leur échange que les produits du travail acquièrent une objectivité de valeur socialement identique, distincte de leur objectivité d’usage et de sa diversité sensible », MEW 23, S. 87f./Capital, p. 84 ; MEGA II. 6, S. 41 et Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert, 1991, S. 220-233.
[8] Dans sa révision de la première édition, Marx avoue s’être fait avoir par cette apparence dans sa propre exposition au début du Capital. Dans la révision de son manuscrit, il écrit, après avoir rapidement esquissé ce qu’il a exposé : « Ainsi le vêtement et le tissu sont, en tant que valeurs, chacun pour soi réduits à une objectivation de travail humain. Mais dans cette réduction il a été omis qu’aucun n’est pour soi une telle objectivité de valeur, alors qu’ils ne le sont qu’autant que cette objectivité leur est commune. En dehors de leur rapport l’un à l’autre, la relation dans laquelle ils se valent, vêtement et tissu ne possèdent pas d’objectivité de valeur ou d’objectivité en tant que pure gelée de travail humain. Cette objectivité sociale, ils ne la possèdent qu’en tant que relation sociale. », MEGA II, 6, S. 30, trad. IJ.
[9] Trenke, S. 9.
[10] MEW, S. 72/Capital, p. 65 et sq.
[11] C’est tout particulièrement à Hans-Georg Backhaus que revient le mérite de n’avoir eu cesse de souligner la signification centrale de l’analyse de la forme-valeur pour la critique de l’économie politique marxienne.
[12] Trenkle, S. 10.
[13] Robert Kurz, Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17. Disponible sur le site internet de la revue Exit ! : https://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=schwerpunkte&index=6&posnr=71&backtext1=text1.php
[14] On trouvera un exposé plus complet sur la loi de la baisse tendancielle des taux de profit dans la Science de la valeur (Die Wissenschaft von Wert, S. 327-340) en partant notamment d’un argument exposé au chapitre 13 du livre I du Capital remettant en question cette loi.
[15] Robert Kurz, Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17, publié en 1995, « L’Ascension de l’argent », disponible sur le site de la revue Exit ! : https://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=schwerpunkte&index=6&posnr=71&backtext1=text1.php
[16] Ainsi, par exemple, la totalité des « frais généraux » dans une entreprise vont être assimilés à des travaux improductifs (Robert Kurz, Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17, 1995, « L’Ascension de l’argent », S. 32f.). Cela est certes juste pour le versement des salaires, mais non pas pour le personnel d’entretien déjà évoqué : alors que le premier est dû seulement à la métamorphose marchandise-argent, l’activité des agents d’entretie constitue l’un des prérequis pour que les forces de travail puissent produire efficacement.
[17] Kurz semble tout à fait conscient de cette circularité puisqu’il remarque que son concept de travail productif peut « paraître inhabituel à la pensée définitoire vérolée de positivisme » (Robert Kurz, Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17, 1995, « L’Ascension de l’argent », S. 35). Ce par quoi de futurs critiques sont déjà remis à leur place : qui, en effet, souhaite être « vérolé de positivisme » ? Si l’on ne se contentait pas seulement de parler, comme le fait Kurz dans son article, de « conception théorique circulaire », mais qu’on remplaçait cette conception par une autre, comme par exemple en partant des schémas de reproduction développés par Marx dans le Livre II du Capital, alors cette circularité se verrait d’emblée évacuée. Dans tous les cas, il ne serait pas exclu qu’avec une définition consistante cette circularité pourrait aussi avoir sa place dans une analyse.
[18] K. Marx,Œuvres, Économie, tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 1120-1157.
[19] MEW 25, S. 120 ; « Die Basis und die Lebensatmosphäre der kapitalistischen Produktionsweise », traduit par Maximilien Rubel de la manière suivante : « le fondement vital du mode de production capitaliste (K. Marx, Œuvres, Économie, tome II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 924).