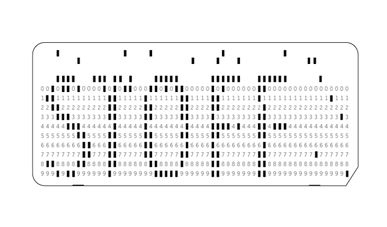Quand nous étions enfants, à Harlem, nos propriétaires étaient invariablement juifs, et nous les détestions. Nous les détestions pour les horribles propriétaires qu’ils étaient, parce qu’ils n’entretenaient pas l’immeuble. Une couche de peinture, une fenêtre cassée, un évier bouché, des toilettes bouchées, des planchers qui s’affaissent, un plafond qui s’effrite, des escaliers dangereux, le problème de la collecte des ordures, du froid et de la chaleur, des cafards et des rats — autant de questions de vie et de mort pour les pauvres, et en particulier pour ceux qui ont des enfants — des questions avec lesquelles il nous fallait composer du mieux possible. Nos parents enchaînaient des emplois sans lendemain, pour pouvoir payer un loyer scandaleux. Nous savions que si le propriétaire nous traitait de la sorte, c’était uniquement parce que nous étions des personnes de couleur et qu’il savait que nous ne pouvions pas déménager.
L’épicier était juif et avoir une ardoise chez lui revenait à avoir une dette dans un grand magasin. Le boucher était juif et, oui, nos mauvais morceaux de viande nous revenaient plus cher qu’aux autres citoyens de New York ; nous rapportions souvent à la maison, avec la viande, notre lot d’insultes. Nous achetions nos vêtements et parfois nos chaussures d’occasion auprès d’un juif et le prêteur sur gages était aussi juif — c’est peut-être lui que nous détestions le plus. Les boutiquiers de la 125e rue étaient juifs — du moins un grand nombre d’entre eux, je ne sais pas si Grant ou Woolworth sont des noms juifs — et je me souviens parfaitement que ce n’est qu’à la suite de l’émeute de Harlem, en 1935, que les Noirs ont eu le droit de gagner un peu d’argent dans ces magasins où ils dépensaient tant.
Tous ces Blancs n’étaient pas cruels — au contraire, je me rappelle de certains d’entre eux, aussi prévenants que les sinistres circonstances le permettaient — mais tous tiraient profit de nous, et c’est pourquoi nous les détestions.
Mais nous détestions aussi les travailleurs sociaux, dont certains étaient blancs, d’autres de couleur, certains juifs, et certains non. Nous détestions les policiers, qui n’étaient pas tous juifs et dont certains étaient noirs. Les pauvres, quelle que soit leur couleur, ne font pas confiance à la justice et n’ont certainement aucune raison de le faire, et dieu sait que nous ne lui faisions aucune confiance. « Si tu dois vraiment appeler un flic », disait-on à l’époque, « pour l’amour de dieu, assure-toi qu’il est blanc. » Nous n’avions pas le sentiment que les flics nous protégeaient parce que nous ne savions que trop bien ce qui motivait les crimes commis dans le ghetto ; mais nous redoutions davantage les flics noirs que les blancs, parce qu’un flic noir devait travailler d’autant plus dur — à nos dépens — pour se prouver, ainsi qu’à ses collègues, qu’il n’était pas comme les autres nègres.
Nous détestions de nombreux enseignants de notre école parce qu’ils nous méprisaient ouvertement et nous traitaient comme des sauvages malpropres et ignorants. Tous n’étaient pas juifs. Certains, malheureusement, étaient noirs. J’avais pour habitude d’aller porter la cotisation syndicale de mon père dans le centre-ville à sa place. Je détestais tout le monde dans ce repaire de voleurs, en particulier le type qui me prenait l’enveloppe des mains, l’enveloppe qui contenait l’argent durement gagné de mon père, cette enveloppe qui contenait le pain destiné à ses enfants. « Voleurs », je me disais, « tous des voleurs ! » Et je savais que j’avais raison, et je n’ai pas changé d’avis. Mais je ne sais vraiment pas si tous ces gens étaient juifs ou pas.
L’armée peut ou pas se trouver sous la coupe des juifs ; je n’en sais rien et je m’en fiche. Je sais que quand j’ai travaillé pour l’armée j’ai détesté tous mes chefs pour leur façon de me traiter. Je ne sais pas si le bureau de poste est juif, mais je détesterais devoir y retravailler. Je ne sais pas si Wanamaker était juif, mais je n’aimais pas faire marcher leur ascenseur et je n’aimais aucun de leurs clients. Je ne sais pas si Nabisco est juif, mais je n’aimais pas nettoyer leur sous-sol. Je ne sais pas si Riker est juif, mais je n’aimais pas récurer leurs planchers. Je ne sais pas si la grosse brute blanche qui trouvait ça amusant de m’appeler « Cireur » était juif, mais je sais que j’ai essayé de le tuer — et qu’il a arrêté de m’appeler « Cireur ». Je ne sais pas si le dernier chauffeur de taxi qui a refusé de s’arrêter pour moi était juif, mais je sais que j’ai espéré qu’il se romprait le cou avant de rentrer chez lui. Et je ne pense pas que General Electric ou General Motors ou RCA ou Con-Edison ou Mobil Oil ou Coca-Cola ou Pepsi-Cola ou Firestone ou le Conseil supérieur de l’enseignement ou le secteur des manuels scolaires ou Hollywood ou Broadway ou la télévision — ou Wall Street, Sacramento, Dallas, Atlanta, Albany ou Washington — soient contrôlés par des juifs. Je pense qu’ils sont sous le contrôle d’Américains et la situation des Noirs américains est le résultat direct de ce contrôle. Et l’antisémitisme chez les Noirs, aussi inévitable qu’il puisse être, et aussi compréhensible, hélas, qu’il soit, ne remet nullement en cause ce contrôle, mais ne vient que le confirmer. Ce n’est pas le juif qui tire les ficelles du manège américain. C’est le chrétien.
***
Ironiquement, l’antisémitisme chez les Noirs trouve ses racines dans la relation entre peuples de couleur — du monde entier — et monde chrétien. C’est un fait qui peut s’avérer difficile à saisir, non seulement pour les habitants les plus anéantis et amers du ghetto, mais aussi pour de nombreux juifs, sans parler de nombreux chrétiens. Mais c’est un fait, et il ne sera pas amélioré — en fait, il ne peut qu’être aggravé — avec l’adoption actuelle du plus dévastateur des vices chrétiens par les gens de couleur.
Bien entendu, il est vrai, et je ne suis pas assez naïf pour ne pas le savoir, que de nombreux juifs méprisent les Noirs, tout comme le font leurs frères aryens. (Il y a aussi des juifs qui méprisent des juifs, tout comme le font leurs frères aryens.) Il est vrai que de nombreux juifs exploitent sans vergogne le massacre de six millions d’entre eux par le Troisième Reich pour faire valoir qu’ils ne peuvent être racistes — ou dans l’espoir qu’ils ne seront pas tenus pour responsables de leur racisme. Il est insupportable de s’entendre dire par un juif que vous connaissez qu’il n’est pas possible qu’il soit en train de faire ce que vous savez qu’il fait, et ce parce qu’il est juif. On ressent une amertume en voyant le commerçant juif fermer sa boutique pour la nuit et rentrer chez lui. Rentrer, avec votre argent dans la poche, dans un quartier bien entretenu, à des kilomètres de distance, dans lequel vous n’aurez jamais le droit de pénétrer. Que cet argent aille en partie contribuer à la cause des droits civiques n’améliore pas davantage la relation entre la plupart des Noirs et la plupart des juifs. À la lumière de ce qui arrive maintenant sous le nom de « contrecoup blanc[1] », on peut simplement voir dans cet argent le moyen de s’acheter une bonne conscience, de l’argent distribué pour que le Noir reste tranquillement à sa place, loin des quartiers blancs.
En bref, on ne souhaite pas s’entendre dire par un juif américain que ses souffrances sont comparables à celles du Noir américain. Ce n’est pas le cas et on peut le savoir à la façon même qu’il a de vous en assurer.
D’une part, le juif américain, par ses efforts (quels qu’ils soient), est parvenu à acheter une sécurité relative à ses enfants et à leur garantir un avenir relatif. C’est plus que ce que les efforts de votre père ont pu faire pour vous, et plus que ce que vos propres efforts ont pu faire pour vos enfants. Il y a des jours où il peut s’avérer excessivement éprouvant d’avoir affaire à certaines célébrités blanches de la musique ou du théâtre qui peuvent ou non être juives — qu’est-ce qu’un nom dans le show-biz ? — mais dont les indécentes rentrées d’argent conduisent à songer avec amertume aux destins d'une Bessie Smith, d’un King Oliver ou d’une Ethel Waters[2]. En outre, le juif peut se targuer de ses souffrances, ou du moins ne pas en avoir honte. Son histoire et ses souffrances n’ont pas commencé en Amérique où l’on a appris aux hommes noirs à avoir honte de tout et de leurs souffrances en particulier.
Les souffrances du juif sont reconnues comme faisant partie de l’histoire morale du monde et le juif lui-même est reconnu pour sa contribution à l’histoire mondiale : ce n’est pas le cas des Noirs. L’histoire juive, qu’on la considère ou non comme étant honorée, est indéniablement connue : l’histoire noire a été pulvérisée, dénigrée et méprisée. Le juif est un homme blanc, et quand les hommes blancs se soulèvent contre l’oppression, ils sont des héros : quand des hommes noirs se soulèvent, ils retombent dans leur sauvagerie natale. L’insurrection du ghetto de Varsovie n’a pas été qualifiée d’émeute et les insurgés n’ont pas été traités de délinquants : les garçons et les filles de Watts et de Harlem en sont résolument conscients et cela participe sans aucun doute de leur attitude envers les juifs.
Mais bien sûr, cette comparaison que je fais entre Watts et Harlem et le ghetto de Varsovie sera immédiatement rejetée comme scandaleuse, et ce pour plusieurs raisons : alors que l’Amérique adore les héros blancs armés jusqu’aux dents, elle ne saurait souffrir les mauvais nègres. Mais la raison fondamentale, c’est que dire qu’une violence gratuite et sans repentir puisse avoir lieu ici va à l’encontre du rêve américain. Nous aimons à croire que nous faisons des erreurs mais que nous nous améliorons sans cesse.
Et, pour le dire avec modération, il s’agit d’un point de vue que n’importe quel Noir sain d’esprit ou sincère trouvera difficile de tenir. Très peu d’Américains, et cela comprend très peu de juifs, sont portés à croire que la condition des Noirs américains est aussi désespérée et dangereuse qu’elle ne l’est. Très peu d’Américains, et très peu de juifs, ont le courage d’admettre que l’Amérique dont ils rêvent et dont ils se targuent n’est pas l’Amérique dans laquelle vivent les Noirs. C’est un pays que le Noir n’a jamais vu. Et ce n’est pas qu’une question de mauvaise foi de la part des Américains. Dieu sait que ce n’est pas la mauvaise foi qui leur manque, mais il y a quelque chose de plus triste et de plus funeste que ça dans le rêve américain.
Personne, je suppose, ne songerait à accuser feu Moss Hart de mauvaise foi. À la fin de son autobiographie, Un Homme de Broadway, juste après être devenu dramaturge à succès, lorsqu’il rentre pour la première fois en taxi chez lui à Brooklyn, il se dit :
Par la fenêtre du taxi, j’ai longuement observé le visage fermé d’un enfant de dix ans qui dévalait les marches pour aller faire une course quelconque avant de se rendre à l’école, et je me suis revu, dévalant moi-même la rue par de si nombreuses matinées grises, franchissant la porte d’entrée d’une maison en tout point semblable à celle-ci. Mes pensées remontaient le temps et puis repartaient tout à coup vers l’avant, comme à travers un prisme aux multiples facettes — faisant surgir devant mes yeux notre vieux quartier, la maison, les marches, le magasin de bonbons — puis glissaient vers la silhouette des immeubles que je venais de dépasser, la première de la veille, et les critiques dans les journaux que je tenais serrés sous mon bras. Il était possible, dans cette merveilleuse ville, que ce garçon anonyme — comme des millions d’autres — se vit offrir la chance de gravir ses murailles et réaliser ses désirs. La richesse, la naissance, la renommée ne comptaient pas. Les seules références requises par cette ville étaient l’audace de rêver.
Mais cela ne vaut pas pour les Noirs, et même le Noir le plus stupide ou connaissant le plus grand succès ne peut véritablement ressentir les choses de cette façon. Son parcours lui aura coûté trop cher et, à moins qu’il ne soit tout à fait à part et très chanceux, le prix à payer est celui d’une séparation entre lui-même et les autres personnes de couleur ainsi qu’un perpétuel isolement vis-à-vis des Blancs. En outre, pour chaque garçon noir qui parvient à prendre ce taxi, des centaines, sinon plus, auront péri autour de lui, non par manque d’audace de rêver, mais parce que la République méprise leurs rêves.
Il faut peut-être se trouver dans cette situation pour vraiment la comprendre telle qu’elle est. Mais si l’on est un Noir à Watts ou à Harlem, si l’on sait pourquoi l’on s’y trouve et si l’on sait avoir été condamné à y demeurer à perpétuité, on ne peut manquer de voir dans l’État et le peuple américains ses propres oppresseurs. Parce que c’est, après tout, exactement ce qu’ils sont. Ils vous ont parqué là où vous vous trouvez pour leur bien-être et leur profit, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher de découvrir suffisamment de choses à propos de vous-même pour pouvoir apprécier la seule vie que vous ayez.
***
On ne souhaite pas croire que le Noir américain puisse ressentir les choses de cette façon, mais c’est parce que le monde chrétien a été confondu par sa propre rhétorique et s’est enivré de son propre pouvoir.
Pendant de nombreuses générations, les natifs du Congo belge, par exemple, ont subi les plus indescriptibles atrocités entre les mains des Belges, entre les mains de l’Europe. Leurs souffrances se sont déroulées en silence. Ces souffrances n’ont pas été rapportées avec indignation par la presse occidentale, comme l’auraient été les souffrances d’hommes blancs. Les souffrances de ces natifs ont été considérées nécessaires, hélas, pour la domination européenne et chrétienne. Et puisque le monde dans sa grande majorité ne savait rien des souffrances de ces natifs, quand ils se sont soulevés, ils n’ont pas été célébrés comme des héros combattant pour leur terre mais condamnés comme des sauvages avides de chair blanche. Le monde chrétien estimait que la Belgique était un pays civilisé ; non seulement les Congolais n’avaient aucune raison de penser la même chose de la Belgique, mais il n’y avait aucune possibilité qu’ils puissent le faire.
Que dira le monde chrétien, qui est actuellement pris d’un mutisme inquiet, lorsque viendra le jour où les natifs noirs d’Afrique du Sud se mettront à massacrer les maîtres qui les ont depuis si longtemps massacrés ? Il est vrai que deux torts ne font pas un droit, comme on aime à le répéter à ceux qu’on a injustement traités. Mais un tort ne fait pas non plus justice. Ceux qui ont subi l’injustice chercheront à redresser les torts ; ils ne seraient pas des humains s’ils ne le faisaient pas. Ils peuvent rarement se permettre d’avoir des scrupules quant aux moyens auxquels ils auront recours. Ils auront recours à ceux qu’ils auront à leur disposition. De manière générale, ils ne feront pas de distinction entre un oppresseur et un autre et ils n’iront pas non plus chercher la cause ultime de leur oppression.
Dans le contexte américain, ce que l’antisémitisme noir a de plus ironique tient à ce que le Noir reproche réellement au juif d’être devenu un homme blanc américain — d’être devenu, dans les faits, un chrétien. Le juif tire profit de son statut en Amérique et c’est pourquoi il doit s’attendre à ce que les Noirs se méfient de lui. Le juif ne comprend pas que le récit dont il se réclame, le fait qu’il a été méprisé et massacré, n'améliorent pas la compréhension du Noir. Ils ne font qu’augmenter sa rage.
Parce que ce n’est pas ici et pas maintenant que le juif est massacré, et qu’il n’est jamais méprisé ici comme l’est le Noir, et ce parce qu’il est un Américain. Le juif a connu le dur labeur de l’autre côté de la mer et l’Amérique l’a sauvé de la maison de servitude. Mais l’Amérique est la maison de servitude du Noir, et aucun pays ne peut le sauver. Ce que le Noir subit ici, il le subit parce qu’il est un Américain.
Quand un Africain est maltraité ici, par exemple, il fait appel à son ambassade. Le Noir américain qui, disons, est injustement arrêté, sera dans la quasi-impossibilité de se pourvoir en justice. Et cela signifie que parce qu’il est un natif de ce pays — « un de nos nègres » — il n’a, dans les faits, personne à qui faire appel et nulle part où aller, que ce soit à l’intérieur du pays ou en-dehors. Il est un paria dans son propre pays et un étranger dans le monde. Voilà ce que signifie avoir son histoire et ses liens avec sa terre ancestrale totalement éradiqués.
Ce n’est pas ce qui est arrivé au juif, et il a par conséquent des alliés dans ce monde. C’est une des raisons qui font que personne n’a jamais sérieusement suggéré au juif d’être non-violent. Il n’a pas besoin d’être non-violent. Au contraire, la lutte des juifs pour Israël a été saluée comme relevant du plus grand héroïsme. Comment le noir peut-il ne pas soupçonner que ce que le juif dit en réalité, c’est que le Noir mérite la condition dans laquelle il se trouve parce qu’il n’a pas été assez héroïque ? Il est peu probable que les juifs eussent remporté la victoire si les puissances occidentales s’étaient opposées à eux. Mais dans leur lutte pour la liberté, les alliés potentiels du Noir font eux-mêmes face à une opposition occidentale massive et obstinée.
Cela laisse le Noir américain, qui représente théoriquement les pays occidentaux, dans une position cruellement ambiguë. Dans cette situation, ce n’est pas le juif américain qui peut lui dire quoi faire ou le consoler. Au contraire, le juif américain a une connaissance tout juste suffisante de cette situation pour ne pas vouloir l’envisager à nouveau.
***
Enfin, ce que le Noir américain interprète des paroles du juif, c’est qu’il faudrait adopter le point de vue historique, impersonnel sur sa vie et sur les vies de ses proches et de ses enfants. « Nous avons souffert aussi », s’entend-il dire, « mais nous nous en sommes sortis, et votre tour viendra. Quand le temps sera venu. »
Le temps de qui ? On n’a qu’une vie. On peut parvenir à se réconcilier avec la déchéance de sa propre vie, mais se réconcilier avec la déchéance de ses enfants ne peut être une réconciliation. C’est la maladie jusqu’à la mort. Et on sait que ceux qui prodiguent de tels conseils ne sont pas présents sur ces rivages pour les avoir suivis. Ils sont arrivés ici à la suite des mêmes efforts que fait le Noir américain : ils voulaient vivre, pas demain, mais aujourd’hui. À présent, puisque le juif vit ici, comme tous les autres hommes blancs qui vivent ici, il veut que le Noir attende. Et parfois — souvent — le juif le fait au nom de sa judéité, ce qui est une terrible erreur. Dans ce contexte, le fait qu’il soit juif n’a aucune importance. Ce qui importe, c’est seulement qu’il soit blanc, qu’il apprécie sa couleur et qu’il la mette à profit.
Il est visé par des Noirs non parce qu’il agit différemment d’autres hommes blancs, mais parce qu’il ne le fait pas. La distinction majeure qu’il a reçue lui vient de cette histoire de la chrétienté, qui est si bien parvenue à faire des Noirs comme des juifs des victimes. Et il joue à Harlem le rôle qui lui a été assigné par les chrétiens il y a longtemps : il fait leur sale boulot.
Tout comme les bonnes gens du Sud, réellement responsables des attaques à la bombe et des lynchages, ne se trouvent jamais présentes sur les lieux, de même les gens qui possèdent réellement Harlem ne se montrent jamais à la porte pour encaisser le loyer. On risque d’être taxé de calomnie en énonçant cela trop précisément, mais Harlem est réellement aux mains d’une curieuse coalition de quelques églises, de quelques universités, de quelques chrétiens, de quelques juifs et de quelques Noirs. La capitale de l’État de New York, qui n’est pas juif, est Albany, et le Moïse[3] qui nous a été envoyé, quel que soit la lignée dont il descend, a certainement échoué à libérer les enfants captifs.
***
Une confrontation véritablement sincère entre Noirs américains et juifs américains s’avérerait certainement d’une valeur inestimable. Mais le pays a de pitoyables aspirations bourgeoises et la bourgeoisie ne peut jamais se permettre la sincérité.
Ce qui est vraiment en jeu, c’est le mode de vie américain. Ce qui est vraiment en jeu, c’est de savoir si les Américains ont déjà une identité ou s’ils sont encore suffisamment flexibles pour en façonner une. C’est un problème douloureusement compliqué, parce que ce qui passe actuellement pour une identité américaine est en fait un mélange stupéfiant et parfois démoralisant de nostalgie et d’opportunisme. Par exemple, les Irlandais qui défilent le jour de la Saint-Patrick n’ont après tout aucun désir de retourner en Irlande. Ils n’ont pas l’intention de retourner y vivre, même s’ils peuvent rêver d’y retourner à l’heure de leur mort. Leurs vies, dans l’intervalle, se trouvent ici, mais ils se raccrochent en même temps à ces références bâties dans le Vieux monde, des références qui ne peuvent être reproduites ici, des références dont ne dispose pas le Noir américain. Ces références constituent l’histoire délaissée de l’Europe — l’histoire délaissée et romancée de l’Europe. Les juifs russes n’ont pas non plus le moindre désir de retourner en Russie et ils ne sont pas partis en masse vers Israël. Mais ils jouissent de la certitude qu’il est là-bas. Les Américains ne sont plus européens, mais ils vivent toujours, ou du moins imaginent-ils le faire, sur ce capital.
Ce capital appartient cependant aussi aux esclaves qui l’ont créé pour le compte de l’Europe et qui l’ont créé ici ; en ce sens, le juif doit comprendre qu’il fait partie de cette histoire de l’Europe et qu’il sera considéré comme tel par le descendant de l’esclave. C’est-à-dire toujours, à moins qu’il ne soit lui-même prêt à démontrer que ce jugement est inapproprié et injuste. C’est précisément ce qu’on demande à tous les autres hommes blancs de ce pays et le juif ne trouvera pas cela plus facile qu’un autre.
L’espoir d’un dialogue entre Noirs et Blancs dans ce pays dépend en dernière instance de la reconnaissance que le serf européen a simplement, dans son élan, créé un autre serf ici, et qu’il l’a créé sur la base de la couleur de peau. Personne ne peut nier que le juif a joué un rôle là-dedans, mais il ne fait aucun sens d’affirmer qu’il l’a fait en vertu de sa judéité. Si on est assez romantique, on peut être déçu du juif pour n’avoir pas tiré les leçons de l’histoire — mais si les gens tiraient des leçons de l’histoire, l’histoire serait très différente.
Toutes les positions racistes me sidèrent et me révulsent. Aucun d’entre nous n’est différent d’un autre, ni tellement meilleur, ni tellement pire. De plus, quand on adopte une position, on doit chercher à comprendre où elle conduit inévitablement. On doit se demander, si on décide que des gens — noirs, blancs ou juifs — sont, par définition, méprisables, si on est prêt à assassiner un bébé noir, blanc ou juif : parce que c’est à cela que conduit cette position. Et si on condamne le juif pour être devenu un Américain blanc, on peut tout à fait, si l’on est noir, parler sous le coup de l’envie.
Si l’on condamne le juif pour n’avoir pas été anobli par son oppression, on ne met pas en accusation la seule figure du juif, mais l’intégralité de la race humaine tout en faisant une déclaration époustouflante sur soi-même. Je sais que ma propre oppression ne m’a pas anobli, et je ne le pensais même pas quand je me considérais encore comme un chrétien pratiquant. Je sais aussi que si aujourd’hui je me refuse de haïr les juifs, ou qui que ce soit, c’est parce que je sais ce que cela fait d’être haï. J’ai appris cela des chrétiens, et j’ai cessé de pratiquer ce que pratiquaient les chrétiens.
La crise qui se déroule dans le monde, dans les cœurs et les esprits des hommes noirs partout, n’est pas produite par l’étoile de David, mais par la vieille croix romaine bien robuste sur laquelle le juif le plus célébré par la chrétienté a été assassiné. Et pas par des juifs.
[1] White backlash, hostilité des Blancs face aux avancées du mouvement des droits civiques — NdT.
[2] Outre d’être noirs, les grandes figures du jazz Bessie Smith (1894–1937) et King Oliver (1885–1938) ainsi que la chanteuse et actrice Ethel Waters (1895-1977) ont ceci de commun que leurs carrières stagnèrent ou déclinèrent à au moins un moment de leurs vies respectives — NdT.
[3] Moses : il s’agit de Robert Moses, urbaniste ayant œuvré à transformer la ville pendant près de quatre décennies — NdT.